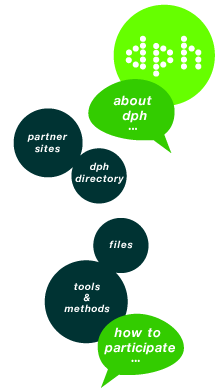Les relations franco-allemandes peuvent-elles servir de précédent au Rwanda ?
Alfred GROSSER, Claire MOUCHARAFIEH
10 / 1994
Les leçons tirées des relations franco-allemandes peuvent-elles servir à d’autres conflits ? La question n’est pas posée pour la première fois. J’ai dû y répondre dès les années soixante-dix à Jérusalem. Pendant un séjour d’enseignement à Tokyo, il m’a été demandé comment le Japon pouvait établir des relations analogues avec la Corée ou avec la Chine. Enfin, du fond même de l’horreur et de la désolation, l’avenir des rapports entre Croates et Serbes est-il moins désespéré, désespérant, si l’on fait référence au cas franco-Allemand ?
Dans le premier cas, il était clair que l’avenir présupposait la fin de la lutte armée. Ce qui s’est passé depuis la signature de l’accord israélo-palestinien diffère du cas franco-allemand sur un point fondamental : ce sont ceux-là même qui ont mené des actions meurtrières qui essaient de construire un avenir positif, alors qu’en Allemagne, c’est le rejet du nazisme, le changement radical de l’idéologie et du pouvoir politique qui a permis la coopération. Pour le Japon, le point central était la nécessité de reconnaître, de faire accéder à la mémoire, les crimes commis au nom de ce pays contre les autres. Or, à l’opposé de l’Allemagne, le gouvernement, les partis, la presse, les livres scolaires japonais font silence sur ce passé meurtrier. Il y a un point commun avec la situation dans l’ancienne Yougoslavie.
Après la publication de mon livre « le crime et la mémoire », j’ai reçu, parmi les lettres critiques, une écrite par un prêtre catholique croate, une autre par un prêtre orthodoxe serbe. Chacun me reprochait de n’avoir pas assez parlé des crimes commis contre sa communauté par l’autre groupe. Je leur ai répondu avec quelque vivacité que la paix ne pourrait exister que si chacun d’eux faisait prendre conscience à sa propre communauté des crimes qui avaient été infligés en son nom à l’autre.
Nous touchons là à la première spécificité des premières tentatives franco-allemandes dès le lendemain de la guerre. Les participants allemands des rencontres devaient, de retour chez eux, raconter les souffrances infligées aux Français et ces derniers devaient, à leur retour, faire connaître chez eux ce qu’avaient été les nuits allemandes sous les bombes et le sort des millions d’expulsés de l’Est dont des centaines de milliers avaient péri en route.
Il ne s’agit en aucune façon de « culpabilité collective », ni d’une quelconque faute à imputer aux héritiers. Il s’agit d’un poids qu’il faut assumer ensemble. Ce qui fut par l’Allemagne plus que par n’importe quel autre pays. Tout récemment, le 1er juillet 1994, le nouveau président de la République, Roman Herzog, a encore déclaré lors de son discours inaugural : « L’unicité historique de l’horreur d’Auschwitz n’est pas un thème de querelle pour les historiens, mais constitue une responsabilité et une charge pour tous. »
L’autre spécificité du rapprochement franco-allemand, la principale, est que sa base n’a pas été nationale. Il convient de citer ici la première phrase du Préambule de la Constitution française de 1946 - ce préambule qui constitue aujourd’hui la charte des droits et des libertés à laquelle se réfère sans cesse le Conseil constitutionnel. On y lit : « Au lendemain de la victoire remportée… sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine…".
Au lendemain de la Première guerre mondiale, on aurait écrit « sur les nations » ou « sur les peuples ». Pourquoi ? D’une part, des milliers de Français avaient directement ou indirectement servi Hitler; de l’autre, de très nombreux Allemands se sont opposés à Hitler. Lorsque les premiers déportés français sont arrivés à Buchenwald ou à Dachau, ils y ont trouvé des milliers de détenus et d’internés allemands.
Le travail franco-allemand s’est fait au nom d’une responsabilité commune pour l’avenir de la démocratie libérale dans les deux pays. Dès octobre 1945, la revue « Esprit » publiait un article de Joseph Rovan, libéré de Dachau en mai, intitulé « L’Allemagne de nos mérites ». Le comité français d’échanges avec l’Allemagne nouvelle, dont j’ai été le secrétaire général jusqu’à sa dissolution en 1967, avait un Comité directeur composé d’anciens résistants ou (et)déportés de toutes tendances, le mot « échanges » signifiant que nous placions nos interlocuteurs allemands sur un pied d’égalité.
Depuis près d’un demi-siècle, je réponds toujours de la même façon à la question posée par un nombre toujours excessif de mes compatriotes : « Faut-il avoir peur de l’Allemagne ?". « Peur ? Jamais. Des craintes pour l’avenir de l’Allemagne ? Toujours ! A deux conditions : que nous les éprouvions solidairement avec les Allemands qui ont les mêmes soucis et que nous leur reconnaissions le droit d’éprouver des craintes pour l’avenir de la France! .
Que peut-on transposer à Kigali ?
On ne peut esquisser que quelques idées : 1. Le refus de la dimension purement nationale de l’affrontement passé pourrait correspondre au refus de réduire l’horreur à un affrontement « tribal ». D’autant plus que les victimes Hutus étaient surtout des gens qui avaient refusé la simplification ethnique. De même, pendant la guerre d’Algérie, c’étaient les libéraux, les tolérants, les fraternels des deux camps qui étaient tués par les « durs » de l’un et de l’autre camp).
2. Le passé est à connaître et à assumer. A partir d’un principe : le fait d’avoir appartenu à un groupe-victime ou même d’avoir été victime soi- même de la torture ou de la tuerie de sa famille ne justifie jamais que l’on devienne bourreau à son tour (cas d’Erich Honecker, victime d’Hitler puis bourreau de son peuple, cas d’officiers français torturés comme résistants, puis responsables de tortures en Algérie).
3. Il faut bien comprendre que la « mémoire collective » n’est pas une donnée évidente; elle est transmise, acquise. Notamment par l’enseignement et les médias. D’où l’extrême importance de la représentation du passé à l’école, à la radio, à la télévision. Il ne s’agit en aucun cas d’oublier l’horreur passée, l’horreur subie. Mais il s’agit aussi de ne pas généraliser, de s’opposer aux généralisations. Il y eu des Tutsis criminels, il y a eu des Hutus criminels, mais l’article défini « les » et le pronom « ils » sont inacceptables parce que générateurs de crimes et de souffrances futurs.
4. Il faudrait châtier ou du moins écarter du pouvoir les ordonnateurs, les instigateurs du crime. Mais pour la masse des complices, il faut prévoir une pédagogie de la réinsertion. Sinon, le risque est de se trouver en face d’une masse de gens pleins d’un ressentiment générateur du désir de vengeance contre l’ostracisme subi. Mais que tout cela est donc difficile au lendemain d’un crime génocidaire !
Key words
national reconciliation, collective memory, peace education, representation of the enemy, experience enhancement, rehabilitation of victims
, Germany, France,
file
Ébauche pour la construction d’un art de la paix : Penser la paix comme stratégie
Expériences et réflexions sur la reconstruction nationale et la paix
Notes
L’auteur, franco-Allemand, est professeur émérite de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Auteur de l’ouvrage « Le crime et la mémoire » (1991). Prix de la paix de l’Union des éditeurs et libraires allemands, comme « médiateur entre Français et Allemands, incroyants et croyants, européens et hommes d’autres continents », en 1975.
Texte envoyé suite à l’appel international à contribution lancé par la FPH pour l’organisation de la rencontre internationale sur la reconstruction du Rwanda (Kigali, 22-28 octobre 1994)co-organisée par la FPH et le CLADHO(Collectif des Ligues et Associations de défense des Droits de l’Homme).
Source
Original text