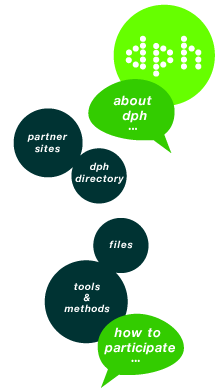Le projet DiverCité consistait à proposer des espaces de discussion libre entre professionnels et habitants sur les tensions et incompréhensions, d’origine culturelle ou autre, qui pouvaient survenir entre eux. La notion de solidarité, qui se situe au cœur de la mission des professionnels et de leurs relations aux habitants, a tout naturellement été choisie comme un thème de discussion. Elle est d’autant plus adaptée à une démarche interculturelle qu’on constate la coexistence de diverses conceptions de la solidarité, parfois opposées entre elles, et que c’est aussi un thème qui donne lieu à de nombreuses idées reçues de part et d’autres.
Ici et là-bas : des formes contradictoires de solidarité ?
Contrairement à ce que l’on pourrait peut-être imaginer (notamment chez ceux qui considèrent le système de protection sociale français comme bien trop généreux, ou bien à l’inverse ceux qui y voient un idéal impossible à critiquer), les migrants qui ont participé aux rencontres de DiverCité ont plutôt eu tendance à valoriser la manière dont les choses se passent dans leur pays par rapport à ce qui se passe en France.
Le principal sujet de critique était relatif au soin des personnes âgées et des enfants. Les migrants ont quasi unanimement estimé qu’il était beaucoup plus facile de régler ce genre de souci dans leur pays qu’en France. Cela tient à plusieurs facteurs. Le premier est que dans ces pays, par rapport à la France et tout particulièrement à Paris, les horaires de travail sont beaucoup plus souples et adaptés. Ensuite, et surtout, les familles savent qu’elles peuvent compter sur la solidarité de la famille élargie et/ou sur celle des voisins. « Il y a toujours quelqu’un pour s’occuper des personnes âgées, ou des enfants. », déclarent les femmes qui ont participé à ces discussions (et d’ailleurs souvent enfants et personnes âgées s’occupent mutuellement les uns des autres). Elles ont le sentiment qu’en France cela ne vaut plus, et que les enfants sont laissés dans des garderies et – plus contestable selon eux – que les personnes âgées sont laissées seules, dans des maisons de retraite, sans que les enfants aillent les voir très souvent. Dans leur pays, il serait inconcevable qu’on laisse ses parents tout seuls. Les discours culpabilisateurs émanant du sommet de l’État après la canicule de 2003 en France et les victimes qu’elle a occasionnées ont évidemment entretenu cette impression – l’exemple a été constamment invoqué.
Bien sûr, il y a beaucoup de préjugés dans une telle accusation. Les familles françaises (tout comme les voisins) aident également souvent au soin des personnes âgées et des enfants, même s’il est possible que cela soit à un degré moindre que dans les pays d’origine des migrants du fait de la mobilité sociale et d’un moindre sens d’obligation du fait de la présence de l’État. (Étrangement, il semble que le sens de la solidarité de voisinage soit aujourd’hui plus fort en France dans les villes, ou du moins dans les quartiers populaires, que dans les campagnes : le cas a été évoqué d’un couple qui a voulu retourner dans son village d’origine au moment de la retraite, mais qui ont fini par revenir dans leur « cité » où, au moins, les voisins s’occupaient d’eux.) Inversement, on peut se demander si les choses ne sont pas en train de changer dans les pays d’origine, à commencer par les grandes villes : il a été dit au cours des discussions que la toute première maison de retraite de Dakar venait récemment d’ouvrir ses portes.
Ce à quoi renvoient fondamentalement de telles critiques, c’est en fait la différence entre deux formes de solidarité – la solidarité personnelle, qui est le principal et parfois l’unique recours au pays, et la solidarité impersonnelle et indirecte, par l’intermédiaire de l’État, qui occupe en France une place importante et, dans bien des cas, dominante. La retraite, financée par les gens qui travaillent, et même les maisons de retraite subventionnées, sont bien des formes indirectes de solidarité. Or on constate que, souvent, les migrants ont du mal à concevoir qu’il s’agisse bien là aussi de solidarité, tout comme d’autres choses dont ils ne bénéficient pas chez eux comme l’école gratuite jusqu’à 16 ans, les soins de santé quasi gratuits (alors que dans de nombreux pays il faut payer avant de se faire soigner). Le fait que l’État soit l’intermédiaire obligé de ces dispositifs de solidarité peut aussi être source de méfiance pour des personnes venues de pays où le rapport à l’État est bien plus problématique, comme la Chine. Une participante a également contesté qu’il s’agisse là de solidarité parce qu’elle est « imposée ». Mais la solidarité familiale ou « communautaire » est dans les faits tout aussi obligatoire, et inversement les dispositifs institutionnels de solidarité sont issus des choix démocratiques des citoyens français.
Par ailleurs, le système français a des avantages que les autres n’ont pas forcément, même si l’inverse est aussi vrai. Comme le dit une participante, au pays les personnes âgées ont plus d’affection, mais en France elles ont des médicaments… Il faut aussi ajouter qu’en France la personne âgée est libre de choisir ce qu’elle préfère, si elle préfère rester seule (et la mairie propose des aides pour qu’elle puisse rester chez elle : lui apporter des repas, faire ses courses, etc.), aller en maison de retraite, ou aller avec sa famille. Au pays, c’est inconcevable : de même qu’un enfant ne peut pas laisser son parent âgé seul, parce que ce serait très mal vu (« la honte »), la personne âgée est obligée d’aller dans sa famille, même quand les relations sont tendues. Une participante africaine raconte ainsi que son père aurait préféré rester dans la brousse, mais que comme il n’avait plus personne là-bas, ses enfants l’ont obligé à venir à la ville.
À l’inverse, les Français peuvent avoir parfois tendance à dénigrer les formes personnelles ou directes de solidarité mises en avant par les migrants au motif qu’elles seraient une régression vers la solidarité de « clan », vers le « communautarisme ». Là encore, la réalité doit amener à remettre en cause de telles généralisations. La solidarité de voisinage est au moins aussi importante que la solidarité familiale stricto sensu. D’ailleurs, chez certains migrants comme les Africains, la conception de la « famille » s’avère à l’expérience particulièrement lâche, et certainement non réductible à la famille biologique. À la limite, on appelle plutôt « famille » tous ceux avec qui on est solidaire que l’inverse. Une femme d’origine sénégalaise a ainsi raconté s’être retrouvée seule dans un autre pays après avoir épousé un Malien. Elle a appris le bambara, engagé des relations avec une vieille dame malienne, en lui faisant des cadeaux, de sorte que cette dame est devenue sa « maman » et l’a aidée à s’occuper de ses enfants quand elle travaillait. Finalement, elle s’est trouvée au Mali comme dans son pays natal. Pour elle, arriver en France nécessitait un peu le même genre de démarche : reconstruire des réseaux de solidarité personnelle, que ce soit sur la base d’une même origine (et il est indéniable que ce sont des liens qui comptent), d’une même langue, ou simplement du fait d’habiter dans le même immeuble ou que les enfants vont à la même école.
Au fond, les migrants qui arrivent en France, tout comme d’ailleurs les Français eux-mêmes, sont tout le temps en train de « bricoler », en faisant jouer les différents leviers disponibles pour se débrouiller dans la vie quotidienne : certains jours les enfants resteront à l’étude, certains jours leur grand-mère viendra les chercher, d’autres jours ils iront chez la voisine, et le mercredi ils iront au centre de loisirs… Les gens sont le plus souvent dans des situations hybrides, reposant pour partie sur la solidarité personnelle, familiale ou de voisinage, et pour partie sur les dispositifs institutionnels. Inversement, à en croire les témoignages de ceux qui ont participé aux discussions, leur propre « solidarité » s’exerce indifféremment au bénéfice des voisins, des parents ou des collègues. Les formes possibles de solidarité sont fondamentalement déterminées par les conditions de vie et leurs contraintes. La solidarité africaine renvoie à un mode de vie fondé sur la famille élargie et une moindre pression des horaires de travail et de l’obligation de boucler les fins de mois. La solidarité en France est plutôt conçue pour des familles nucléaires « normales ». En arrivant en France, les migrants peuvent donc être confrontés à une inadéquation entre leurs habitudes de vie, la réalité de leur situation, et ce que les institutions françaises peuvent leur proposer.
La notion de solidarité est-elle véritablement interculturelle ?
Au-delà du débat récurrent entre solidarité personnelle et institutionnelle, plusieurs autres facteurs peuvent affecter la compréhension par les migrants du système de solidarité tel qu’il existe en France. En fait, il est loin d’être évident que l’idée même de « solidarité » soit parlante pour toutes les cultures. Quand on essaie de leur expliquer de quoi il s’agit, les Chinois pensent d’abord « association ». Une femme de langue tamoule pense quant à elle à l’anglais « social service », et quand on lui explique que la solidarité concerne aussi bien les relations personnelles, elle répond qu’en tamoul il y a un autre mot, différent, pour cela. Il semble donc que dans certaines sociétés, on sépare nettement ce qui en France est lié au moins au niveau des mots : l’État et la société, la solidarité officielle et la solidarité personnelle.
Il est peut-être d’autant plus difficile de « faire passer » le sens de la solidarité à la française que celui-ci n’est pas si clair que cela y compris pour les premiers intéressés (voir Le flou des droits (Partie 1) : pourquoi le système social français peut être difficile à comprendre), dans la mesure où il est traversé d’ambiguïtés, voire de conflits. Il y a tout d’abord la pression de l’idéologie néo-libérale : dans sa version la plus extrême, elle considère tout système de solidarité comme illégitime par définition ; dans les faits et les politiques publiques, elle se traduit par la suggestion permanente que la solidarité serait une « faveur », une anomalie qui ne serait maintenue que par générosité. Plus généralement, lorsque l’on demande aux gens de donner des exemples de solidarité, on se retrouve immédiatement face à un inventaire à la Prévert : la solidarité, c’est la CMU, c’est donner sa place à une personne âgée dans le bus, aider quelqu’un à porter ses valises, l’aide humanitaire envoyée dans les pays touchés par le tsunami de 2006, ou encore les impôts et la sécurité sociale, l’entraide, l’échange entre élèves et professeur, la collecte des pièces jaunes pour la sida, etc. Comment retrouver un fil conducteur ? En dernière instance, il semble tout de même que la solidarité soit prise entre deux pôles opposés : d’un côté le pôle du don et celui de l’aide à ceux qui n’ont rien, de l’autre côté le pôle de l’échange et de la réciprocité. Dans un cas, on a un geste unilatéral, de haut en bas, qui peut déboucher sur l’assistanat ; dans l’autre cas il y a une forme d’égalité : on aide pour être aidé. En fait, on peut se demander si ces deux pôles sont si opposés que cela. Ce que l’on donne dans la solidarité, c’est ce que l’on considère comme le minimum que doivent avoir ceux qui n’ont rien : si vous n’avez rien, vous avez quand même quelque chose. Il y a en fait là aussi une forme de réciprocité et d’égalité : la réciprocité vaut entre l’individu et le collectif, elle vise à amener chaque individu à un niveau minimum égal aux autres. Même le don peut donc être une manière de construire du collectif.
Une autre ambiguïté est celle de la limite entre solidarité et responsabilité individuelle, qui n’est pas placée au même endroit, non seulement dans les différentes sociétés, mais même par des individus différents d’une même société. Les différences par toujours explicites qui existent dans ce domaine entre la France et le pays d’origine peut expliquer le sentiment de certains migrants d’être sur-responsabilisés, par rapport à leurs enfants, par rapport à leur « devoir » de trouver par leurs propres moyens un travail et un revenu… C’est un problème qui touche aussi bien les formes personnelles de solidarité que les formes impersonnelles, et par rapport auquel il n’est pas toujours facile de trouver l’équilibre approprié : s’il ne faut pas laisser les gens tout seuls, des formes de solidarité excessives ou mal conçues peuvent avoir des contre-coups négatifs en ce qui concerne l’émancipation des gens. Un dispositif généreux d’assistance sociale doit éviter aussi d’encourager la dépendance. De la même manière, il est très bien que les grands frères se sentent responsables de leurs petits frères et sœurs, mais ils peuvent aussi en faire trop (notamment vis-à-vis des filles…). Il y a effectivement des cas où la solidarité communautaire nuit à la responsabilité individuelle.
La situation est encore plus compliquée au sein de familles en cours d’acculturation à la société française et où la question de la frontière entre responsabilité collective et solidarité imposée, d’une part, et liberté individuelle, de l’autre, fait l’objet de conflits intergénérationnels. Le cas a ainsi été discuté d’un père sénégalais qui a renvoyé son fils aîné du domicile familial parce qu’il considérait que celui-ci n’assumait pas ses devoirs, en tant qu’aîné, de s’occuper de ses petits frères et sœurs, et de partager l’ensemble de ses revenus avec la famille. Le jeune homme s’est retrouvé coincé entre des obligations familiales très lourdes pour un jeune comme lui et une envie de continuer de vivre avec sa famille, sans pour autant être contraint de sacrifier son projet de vie personnel pour assumer son rôle de grand frère, responsable de la famille. L’une des sources du problème est le sentiment de ce jeune homme que les sacrifices qu’il faisait déjà (car il donnait bien une partie de ses revenus au pot familial), de même que ceux qu’il ferait s’il consacrait tout son temps et son argent à sa famille, ne seraient pas reconnus comme tels mais considérés comme « normaux ». Dans un cas comme celui-ci, la médiation des services sociaux ou, mieux, celle d’un autre membre de la famille est nécessaire pour trouver une solution de compromis entre diverses exigences légitimes.
Key words
migration, family, social link, solidarity, State, State intervention
file
Notes
Ce texte fait partie du dossier « Migrations, interculturalité et citoyenneté », issu d’un ensemble de débats et de rencontres organisées dans le quartier de Belleville à Paris entre 2004 et 2009, avec des habitants (issus des migrations ou non) et des représentants de diverses institutions présentes sur le quartier. Les textes proposés dans le dossier reprennent les principaux points saillants de ces discussions, dans le but d’en partager les leçons.