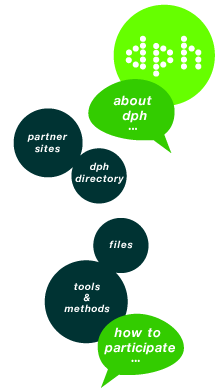L’émergence de la notion de capitalisation d’expérience dans l’histoire de la FPH
Le capital de l’expérience dans la construction d’un savoir partageable
12 / 1999
Dès l’âge de 20 ans, j’étais extrêmement attentif à l’idée que l’expérience est un élément constitutif important du savoir. Cette idée que ce qui est passionnant dans la vie, c’est quand on a l’impression de continuer à se construire, était chez moi ontologique. De ce fait, quand à partir de 1974, je suis devenu responsable d’un service du ministère de l’équipement, je venais déjà avec ce souci de marcher sur deux jambes : réflexion/action. C’est à cette époque que j’ai adapté pour mon propre usage et mon propre service ce que sont devenues les fiches de suivi (1). J’avais remarqué que lorsque mes collègues se mettaient à théoriser ce qu’ils disaient, ils étaient très mauvais, alors qu’ils devenaient passionnants lorsqu’ils racontaient des anecdotes sur ce qu’ils vivaient.
Pour construire une réflexion née de l’accumulation d’expériences, il faut avoir des méthodologies de saisie de l’expérience sur le vif, sinon on reconstruit a posteriori la réalité, et on croit que l’on repart de son expérience, alors qu’en réalité on repart de projections de discours théoriques sur son expérience.
La question de la construction de la mémoire et celle de l’accumulation d’expérience sont directement liées ; de même, l’idée que le discours sur le réel devait mobiliser impérativement les praticiens, mais qu’il fallait trouver les méthodes pour que ces praticiens ne soient pas simplement de piètres théoriciens. Or, en France notamment, il y a des gens sur le terrain qui agissent, d’autres dans les laboratoires ou dans les journaux qui réfléchissent, et ces deux mondes se fascinent mutuellement, se créent mutuellement, se méprisent mutuellement. Je l’ai vécu en tant que chercheur puis homme d’action, chargé de prendre de nombreuses décisions, car ce n’est qu’en agissant dans le réel que l’on comprend le réel. En se contentant de l’observer, on n’a aucune chance d’y avoir accès, et donc il y a une perte phénoménale de pertinence sociale, de l’être en société dès lors qu’on admet cette coupure entre l’action et la réflexion.
Je ne crois pas au discours sur la construction du réel purement par l’empirique. La représentation du réel informe très fortement notre lecture du quotidien, et donc l’interaction entre l’idéologie et ce que l’on fait et comprend est permanente, y compris dans le détail. Je ne crois pas du tout que l’approche qui consisterait à construire la connaissance à partir du quotidien soit une approche plus anglo-saxonne que latine sur le fond des pratiques sociales, mais sur le fond des pratiques des chercheurs sans doute. Les chercheurs anglo-saxons ont plus le souci de la cohérence théorique du discours. Ce qui se vend bien en France, c’est un discours brillant, mais pas de savoir si cela reflète la réalité ou non. C’est un problème interne au monde de la recherche.
Dans les années 1974-76, dans nos expériences de dialogue entre collègues pour nous nourrir mutuellement de nos expériences, nous avons vu qu’effectivement l’élaboration collective d’une connaissance à partir de notre quotidien était à la fois passionnante et très laborieuse. Ce n’est pas si simple que cela de rapprocher les références mentales des uns et des autres, de comprendre ce que l’autre veut dire, d’où cette énorme préoccupation de construction du savoir à partir du capital.
A l’origine, la Fondation devait être pour partie une fondation scientifique mais aussi mener des actions concrètes (2). Puis, très vite, nous nous sommes dit avec Paulette Calame qu’il fallait créer une fondation centrée sur la tension entre la réflexion et l’action. La dialectique réflexion-action est devenue une question centrale, et avec elle la capitalisation d’expérience.
Lorsque j’étais à la Direction des Affaires économiques internationales (DAEI)du ministère de l’Equipement, entre 1983 et 1985, le terme ’ capitalisation d’expériences ’ est apparu, puis est devenu récurrent dans nos propos. J’ignore si nous l’avons inventé ou emprunté, mais en tous cas il y avait cette idée de ’ capitalisation ’.
Nos partenaires de la FPH, qui étaient engagés dans l’action, disaient alors : ’ encore une démarche capitaliste ! Ca veut dire quoi, capitalisation d’expérience ? ’. A présent le terme est à la mode, tout le monde en parle, mais à l’époque c’était incompréhensible et nous avons dû nous battre pour légitimer l’idée.
Dans l’information, il y a du flux et du stock. Il faut travailler à la fois sur la fonction flux et sur la fonction stock, et cette dernière ne doit pas être considérée comme un empilement d’informations mais doit être articulée. La capitalisation d’expérience est un stock d’informations articulées.
La FPH a eu l’idée de mettre à la disposition de ses amis et partenaires, qu’elle prétendait aider, sa propre expérience rendue accessible ; à charge pour eux de déterminer ce qui leur était utile. En effet, dans le rapport entre une expérience et son adaptation, le mouvement ne peut être fait par le porteur de l’expérience qui se transformerait ainsi en conseiller, mais dans l’autre sens : l’interlocuteur doit être en mesure de lire cette expérience à livre ouvert, dans ses clairs et ses obscurs, et non comme une série de belles histoires. Je suis un combattant farouche de la ’ bonne pratique ’ qui est à mes yeux une escroquerie épistémologique. A l’opposé, je suis un partisan farouche de la capitalisation d’expérience, qui est une logique intellectuelle radicalement différente.
Key words
information, transfer of knowledge
, , France
Notes
(1)Les fiches de suivi sont à la FPH un moyen de garder trace des contacts avec les partenaires et de toute réflexion ou information qui peut être utile dans le cadre des programmes menés par la FPH. Ce sont des fiches informatisés, datées, codifiées et indexées. (2)La FPH a été créée en 1982. P. Calame s’est investi à plein temps à la FPH après 1990.
Source
Interview

FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) - 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris, FRANCE - Tél. 33 (0)1 43 14 75 75 - Fax 33 (0)1 43 14 75 99 - France - www.fph.ch - paris (@) fph.fr