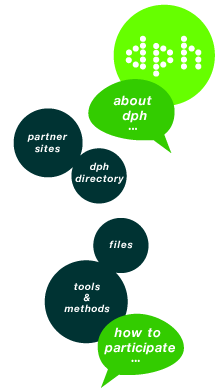Service public et service privé : une radicale hétérogénéité ou des missions communes ?
08 / 1999
Selon Patrick Gibert, Professeur à Nanterre et rédacteur en chef de la revue "Politiques et Management Public", le secteur public, qui se jugeait naguère trop "noble" pour être "géré", souffre maintenant d’un complexe d’infériorité par rapport au privé ; il cherche à y remédier en important des pratiques du privé ou parfois en se contentant de faire semblant, ce qui est heureux selon l’orateur : quand les pratiques sont inadaptées, mieux vaut qu’elles ne soient appliquées que partiellement.
L’impératif apparemment légitime d’efficacité masque en effet une irréductible opposition entre secteur privé et secteur public : avant de chercher à améliorer la productivité, il faudrait réfléchir au juste à ce qu’est la "valeur" dans le secteur public. Il s’agit souvent de valeurs symboliques (au sens fort du terme)et non de valeurs au sens privé. Le secteur public poursuit des objectifs d’équité et de redistribution qui sont incompatibles avec la notion d’efficacité ou de productivité au sens habituel du terme. L’essence du service public est sans doute la péréquation : la gestion publique ne peut donc être que territoriale, alors que la gestion privée est plus "nomade ".
Pour démêler les malentendus sur lesquels se fondent les transpositions abusives du privé au public, P. Gibert distingue également finalité interne et finalité externe : le service public a une finalité externe, qui consiste à changer ou à préserver des états de société, tandis que le secteur privé a avant tout une finalité interne, même s’il peut exister des entreprises citoyennes, et même si le "rôle" que joue IBM dans la société peut apparaître plus important que celui du ministère des Anciens combattants ; la finalité telle qu’elle s’exprime dans les actions quotidiennes est radicalement différente.
Un autre critère de différence est celui de la complexité : le secteur privé poursuit des buts "simples" ; les stratégies et les moyens auxquels il recourt sont faciles à évaluer ; imposer au secteur public de définir une stratégie revient souvent à négliger la complexité de ses missions, et notamment la logique du "tout en" : on fait ceci "tout en" faisant cela, ce qui est normal puisque la demande sociale est complexe et souvent contradictoire. Le modèle de l’entreprise est au contraire un "rêve de cohérence ".
Sont enfin incriminées, parmi les outils importés du public, les évaluations quantitatives : substituer une fonction de production à la mission de régulation qui caractérise l’administration conduit à des erreurs grossières. Ainsi, lorsque l’ANPE, pour se moderniser, adopte un indicateur qui mesure le nombre de personnes placées, cela pousse ses services à s’occuper prioritairement des chômeurs faciles à placer, de ceux qui auraient de toute façon retrouvé du travail. De même, tel gouvernement augmente le nombre de formations universitaires en sociologie parce qu’une étude a montré que le coût par étudiant formé est plus faible en sociologie qu’ailleurs.
Sans doute introduire quelques indicateurs chiffrés peut-il avoir un sens, mais à condition d’en changer fréquemment pour éviter leurs effets pervers, et à condition aussi que l’évaluation s’exerce jusqu’aux plus hautes sphères de la fonction publique, ce qui, d’après l’orateur, n’est généralement pas le cas...
Key words
public administration, productivity, public sector, public service, company, national and regional planning, assessment, private sector
, France
Comments
La conception selon laquelle "le privé produit, le public régule" est extrêmement séduisante : plus on creuse l’écart entre ces deux fonctions, plus on peut espérer cumuler les avantages de deux secteurs destinés à se compléter et non à se concurrencer. Evaluer la productivité du secteur public selon les méthodes du secteur privé paraît dans ce cadre tout aussi risqué que de subventionner à tour de bras un secteur privé qui ne se donne nullement pour objectif de "réguler ". Mais est-il si sûr qu’il faille indéfiniment maintenir ce "taylorisme social" entre production et régulation ? ne correspond-il pas à une étape historique qu’il faudrait maintenant envisager de dépasser, en considérant que la vie civique ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise, et qu’un service public qui s’avère par trop inefficace perd de sa légitimité ? Pourquoi, dans ce cas, ne se livrerait-on pas, au moment où les administrations font l’objet de toutes sortes d’évaluations plus ou moins adaptées, et dont certaines, proprement scandaleuses, doivent en effet être dénoncées, à une évaluation, en parallèle, des fonctions sociales de l’entreprise, à côté de sa fonction de production et de rentabilité ?
Une entreprise, même sans avoir été mandatée pour une "mission de service public", apporte quelque chose à la société, ou peut au contraire entraîner divers troubles que le service public devra, d’une manière ou d’une autre, compenser. Est-il possible, sans revenir au paternalisme ni aux corporations, d’imaginer que les entreprises pourraient être encouragées à prendre en charge certaines fonctions de service public, en cohérence avec le rôle qu’elles jouent objectivement dans la société ?
Source
Colloquium, conference, seminar,… report ; Articles and files
GIBERT, Patrick, MATHEU, Michel, Ménager la publicitude - séminaire 'Les Petits déjeuners confidences' in. Les Annales de l'Ecole de Paris, 1995 (France), I
Ecole de Paris de Management - 94, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris, FRANCE - Tél. 33 (0)1 42 79 40 80 - Fax 33 (0)1 43 21 56 84 - France - ecole.org/ - ecopar (@) paris.ensmp.fr