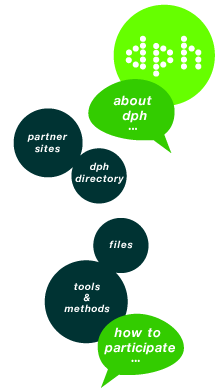Si l’on se penche sur la difficulté des peuples indigènes d’Amérique latine à accéder aux leviers du pouvoir dans leurs pays, on doit vite se rendre à l’évidence que cette marginalisation est due à différents facteurs.
La volonté politique d’une grande partie de la classe dominante d’extraction européenne de maintenir ce statu quo est évidente, que ce groupe soit, selon les pays, démographiquement majoritaire ou minoritaire. Elle n’est pourtant pas l’obstacle le plus infranchissable pour espérer une plus grande participation des populations pré-colombiennes à la gestion des affaires du pays.
Certains gouvernement ont démontré leur volonté d’avancer sur cette voie avec beaucoup de franchise. Toutefois ce genre d’expérience nous a montré que très souvent les indiens qui s’impliquent dans le processus politique national sont vite absorbés par le moule du jeu politique à l’occidentale, au détriment de leurs attaches - et par conséquent de leur légitimité - au peuple même dont ils sont originaires.
Ce constat remet en question évidemment les tentatives bien fondées d’impliquer les populations indiennes dans la politique nationale. Ces tentatives rencontrent des obstacles qui résultent d’un certain degré d’incompatibilité entre l’organisation des pouvoirs au sens large selon le modèle démocratique à l’occidentale et celui de la communauté indienne.
Le concept de peuple, chez les occidentaux n’existe que dans une perspective culturelle - voir éventuellement religieuse - mais sans implication aucune dans la gestion des pouvoirs "temporels". Cette notion de peuple est par contre un des piliers de l’organisation traditionnelle indienne. Elle est très étroitement associée à la relation à la terre. De l’attachement à la terre qui prend valeur de symbole, en plus de son importance matérielle évidente, jaillit la dimension collective des relations inter-personnelles et inter-conununautaires de la vie indigène.
Cette caractéristique institue un type de relation entre les détenteurs d’un pouvoir et ceux qui le lui ont attribué, pour ainsi dire inverse au type de relation existant entre l’administrateur et les administrés dans les sociétés occidentales. En fait le "chef’ indien (temporel ou spirituel)est moins le détenteur du pouvoir que le dépositaire d’un mandat précaire et de courte durée. Ce mandat - la plupart du temps dévolu aux hommes plutôt qu’aux femmes - est ni un droit ni un privilège, mais bien plus un devoir vis-à-vis du groupe.
Le fait de suivre le cursus des fonctions au sein du groupe est un passage obligé pour tous en vue d’obtenir la reconnaissance sociale. Une des conséquences de cette norme est un cycle de rotation très rapide de cette détention du pouvoir (une année dans la plupart des cas), et par conséquent une dépersonnalisation de la fonction.
Dans sa nature, le mandat ne dépasse pas la mise en ouvre de décisions collectives. La collectivité retient en effet l’intégralité du pouvoir de décision qu’elle exerce la plupart du temps dans un esprit de consensus plutôt que selon des règles majoritaires. Ceci inévitablement augmente les délais pour les prises de décision, mais permet de maintenir la cohésion du groupe.
Ce processus du consensus est aussi utilisé pour le choix des dirigeants. Les conflits de personnes sont considérablement réduits du fait du caractère rotatif et obligatoire de l’exercice du pouvoir.
La désignation des dirigeants et leur mandat, selon l’approche indienne rend complexe la délégation de pouvoir et la représentativité indirecte d’une communauté et a fortiori d’un peuple. On le constate couramment auprès des organisations indiennes prétendument représentatives. Elles sont très vite le lieu de querelles de personnes plutôt que d’idées. La perte de légitimité du dirigeant est, par ailleurs, directement proportionnelle à son éloignement par rapport à son cadre d’origine.
Là encore, on rencontre une situation inverse à celle du système de représentativité à l’occidentale qui tend à accorder plus de légitimité aux détenteurs d’un pouvoir au fur et à mesure qu’il gravit les échelons de la responsabilité.
Le peuple indien ne se reconnait pas dans ses dirigeants. Et hors de son groupe d’origine, le dirigeant indien perd de sa légitimité. Les systèmes constitutionnels latino-américains hérités des révolutions post-coloniales se sont directement inspirés des modèles occidentaux. Ils sont encore gérés autour de cette idée de la démocratie représentative. C’est dans ce cadre qu’avec beaucoup de spontanéité certaines nations veulent impliquer leur population indienne dans le système de gouvernement.
Key words
citizenship, State and civil society
, Nicaragua
Comments
Cette bonne volonté a souvent beaucoup de mal à surmonter les obstacles de la nature profonde du pouvoir indien. Ceci se retrouve à des degrés différents au Mexique, au Panaina, en Colombie, en Equateur, en Bolivie et au Chili, les autres pays d’Amérique latine n’ayant jusqu’à présent pas produit d’efforts réels pour associer les indiens à la gestion des affaires publiques.
Enfin, il faut souligner que cette analyse plutôt pessimiste est doublement vérifiée dans le cadre des organisations internationales qui cherchent sur certains sujets à impliquer les nations indigènes dans la détermination des grandes orientations. A la nuance près, toutefois, qu’on assiste dans ce cadre là à la constitution d’un corps international d"’êtres politiques" indigènes qui manient un discours incontestablement favorable aux peuples qu’ils entendent représenter, et pour lesquels finalement la légitimité de leur mandat est d’importance secondaire.
Notes
Diego Gradis est responsable de "Traditions pour demain", réseau associatif contribuant à la promotion et la défense des identités amérindiennes.
Source
Original text