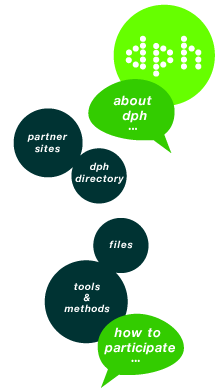Les deux voies de la citoyenneté urbaine
Relancée avec force, en 2003, sous l’impulsion de Jean-Louis Borloo, la politique de la ville a été reconduite par Nicolas Sarkozy qui en a conservé les trois principales composantes, à savoir, d’abord la discrimination positive territoriale ( les compensations accordées aux zones urbaines sensibles, aux zones de redynamisation et aux zones franches), la rénovation urbaine devenue la pièce centrale du dispositif , celle qui nécessite de loin les plus gros investissements, reléguant, si l’on peut dire, au second plan, la dimension sociale avec la création des contrats urbains de cohésion sociale(CUCS) plus ou moins associés, selon les lieux, aux contrats locaux de prévention et de sécurité (CLSPD).
Il a tenu toutefois à lui apporter une touche particulière avec le Plan espoir Banlieue porté par Fadela Amara. Fruit officiellement d’une longue série de rencontres organisées par les préfets dans les villes de banlieue, ce plan porte surtout l’empreinte du sarkozysme travers les trois orientations qui le caractérisent. L’accent mis d’abord sur la volonté de « donner leur chance » aux jeunes des banlieues qui décident de s’en sortir et d’en sortir, dans le domaine scolaire, grâce à la création d’ internats, d’écoles dites d’excellence, au renforcement de la formule des « écoles de la seconde chance », et dans le domaine de l’emploi par la création de « contrats d’autonomie » offerts aux jeunes qui recevaient un pécule durant six mois contre l’acceptation d’un accompagnement par des professionnels chargés de les amener vers un emploi ou une formation. Il s’agissait ainsi de relever ostentatoirement le niveau de la dimension sociale de l’action afin qu’elle ne se réduise pas à l’attribution de subventions à la vie associative pour préserver la paix sociale. D’autant que, dans ce domaine de la sécurité, second volet du plan en question, Sarkozy tient à apporter sa touche personnelle avec un renforcement du dispositif policier, la création, en l’occurrence, d’une nouvelle sorte de police de proximité : les unités territoriales de quartier (UTEQ). Nouvelle, cette police l’était surtout par son armement, les fameux flashball, mais de proximité, cela paraissait moins sûr compte tenu de sa mission de dissuasion des groupements de jeunes plus que de contact avec les habitants. Enfin, la création de délégués du préfet dans chaque quartier sensible : là, c’est encore l’ancien Ministre de l’Intérieur qui se manifeste, avec le souci de mieux faire jouer ainsi l’autorité de l’Etat sur les services, de réaliser par lui-même cette coordination que les élus locaux semblaient peiner à établir efficacement.
* * *
Considérée sur un plan historique, cette politique de Sarkozy pour les banlieues ne modifie pas tant celle-ci qu’il ne prolonge et accentue son infléchissement à droite depuis le milieu des années 90. Mieux : elle en dégage plus clairement la philosophie : celle, en l’occurrence, d’un interventionnisme public qui traite vigoureusement les lieux pour pouvoir sommer les individus de choisir entre la chance qu’on leur offre et la répression qui les menace. Précisons. Avec le Plan Juppé(1996), le traitement des lieux l’avait emporté sur le souci des gens. On ne parla plus de quartiers mais de zones. Les quartiers évoquaient justement le développement social, tandis que la zone met l’accent sur le développement économique. Si un espace s’appauvrit, c’est que le marché le déserte parce qu’il n’y trouve pas son compte. Il convient donc de le rendre avantageux aux investisseurs pour qu’ils y reviennent et le bon moyen pour cela consiste en l’exonération de charges sociales et/ou fiscales. Agir sur les lieux, c’est aussi mettre l’accent sur le bâti plus que sur les relations entre les gens, sur la vie associative. Tel fut bien le sens du programme de rénovation urbaine édicté par Jean-Louis Borloo. Non que la gauche n’ait partagé ce souci de rénovation avec la loi solidarité et renouvellement urbain (2000). Mais elle tenait précisément à associer les opérations en question à actions en matière sociale. Avec le programme de J-L Borloo, les deux registres se trouvent dissociés et le social nettement secondarisé. A ces deux premières inflexions, le plan de Nicolas Sarkozy en apporte une troisième qui vaut comme la touche finale, la manière de tirer les conséquences au plan social de cette façon de privilégier l’action sur les lieux. Il s’adresse bien aux gens, mais en considérant ceux-ci qu’en tant qu’individus, libérant en quelque sorte le discours politique sur ce sujet de la rhétorique néo-solidariste dans laquelle la gauche l’avait installé. Par néo-solidarisme, on peut désigner cette manière bien particulière qu’avait eue la gauche de reconduire la philosophie sociale de Léon Bourgeois dans un contexte qui semblait l’invalider. Le raisonnement solidariste prenait appui sur la solidarité objective qui existait entre les individus du fait de leur interdépendance dans les relations de travail pour justifier une politique de redistribution sociale. Dans le contexte historique de la mondialisation et dans un cadre géographique comme celui des banlieues, cette interdépendance devenait aussi peu évidente que l’accès à l’emploi. Aussi la gauche entreprit-elle de renverser le raisonnement sur lequel s’appuyait le solidarisme, faisant comme si les conséquences pouvaient valoir comme causes, comme s’il y allait d’une équation avec des termes réversibles. En l’occurrence, le néo-solidarisme consistait à dire : créons des emplois d’utilité sociale (comme les emplois-jeunes) et de cette utilité produite au nom de la solidarité renaitra le sentiment de l’interdépendance.…De cette pieuse opération, Sarkozy a fait en quelque sorte litière , ne considérant les jeunes de banlieue que comme des adolescents auxquels il convient de tendre la main pour qu’ils sortent de « la glandouille » (selon l’expression promue par Fadela Amara) mais qu’il convient de réprimer non moins fermement et sans états d’âme inutiles s’ils ne la saisissent pas.
Ainsi délivrée des « candeurs » de gauche qui avaient marqué cette politique à ses débuts, c’est bien une politique de la ville de droite, « décomplexée » vis-à-vis des questions de sécurité par Nicolas Sarkozy, qui se trouve à présent pleinement déployée. Et qui s’expose, pour le coup, à son appréciation comme telle. D’autant que les ambitions en ont été chiffrés et datés avec précision et assorties de moyens propres d’évaluation comme l’observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) ou le comité d’évaluation et de suivi de l’agence nationale de rénovation urbaine (CES de l’ANRU). Or, les évaluations conduites par ces organismes montrent des résultats plutôt décevants au regard des objectifs qui avaient été fixés.
La déception concerne surtout le programme des zones urbaines dites sensibles. Renforcé en 2003, ce programme avait reçu alors pour mission de ramener les zones en question à la normale dans délai de cinq ans. Le dernier rapport publié par l’observatoire national des ZUS montre qu’il n’en a rien été. Le revenu par habitant n’y a pas changé sensiblement. Le chômage y est toujours le double de la moyenne et l’écart des résultats scolaires par rapport aux autres quartiers reste identique.
Figure de proue de cette politique, le programme de Rénovation Urbaine visait officiellement à réintroduire dans ces quartiers la mixité sociale qui y a disparu et cela grâce à des opérations de démolition et de reconstruction concernant plus de 200 000 logements ainsi que la réhabilitation de 400 000 autres. Mais ce vaste chantier avance lentement et les premières évaluations montrent que ces opérations n’entament que très partiellement la logique de ghetto qu’elles sont censées défaire. Les démolitions vont généralement de pair avec un relogement des familles à proximité des immeubles détruits. Les nouveaux logements, destinés à attirer des classes moyennes dans les parages des cités pour qu’ils y donnent le bon exemple, n’attirent pas des publics vraiment différents de ceux vivants déjà dans le quartier quand ce ne sont pas ceux-là même qui les investissent comme en Ile de France. Bref, au lieu de la mixité promise, c’est plutôt à une fine segmentation interne des quartiers d’habitat social que l’on assiste, à une manière de nuancer le ghetto plutôt que d’en finir avec lui.
Quant au dernier programme, lancé en 2005, celui des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), il constitue surtout le support des nouvelles mesures lancées sous le titre du Plan espoir Banlieue comme celles relatives à l’insertion socioprofessionnelle à travers les « contrats d’autonomie » impulsés par Fadela Amara. Les jeunes reçoivent une indemnité mensuelle de 300 euros pendant six mois contre l’acceptation d’un coaching par des agences devant les conduire à un emploi ou une formation (ce sont surtout des agences privées qui ont été retenues à la suite de l’appel d’offres lancé sur le sujet même si on y trouve quelques missions locales). Sur les 45000 prévus, environ 13000 contrats ont été passés… dont un millier ont conduit à une entrée dans un emploi ou une formation. Les observateurs ont calculé que cela établissait le coût de l’entrée dans un emploi à 30 000 euros par personne. Et ce piètre résultat vaut à la secrétaire d’Etat d’essuyer pas mal de sarcasmes.
* * *
Constatant le peu de résultats de cette politique, le gouvernement s’oriente visiblement vers sa reformulation a minima. Tel parait bien le sens du rapport Hamel et André, publié l’été dernier, qui propose de maintenir les opérations engagées en matière de rénovation urbaine et, pour le reste, de concentrer l’effort sur un petit nombre de quartiers très défavorisés relevant de communes ne disposant que de peu de moyens, laissant aux mieux nanties la charge de concevoir elles-mêmes leur action selon des plans d’ensemble que l’Etat abondera à son gré. Dans le contexte actuel de sérieux déficit budgétaire et compte tenu de la culture du résultat dont ce gouvernement fait étal, une telle réaction parait logique.
On peut toutefois estimer que ces résultats décevants devraient valoir remise en question non pas tant des moyens de cette politique que de l’orientation trop partiale qui lui a été ainsi donnée, des postulations sur lesquels elle repose. Le premier postulat consiste en cette idée qu’il suffit de traiter les lieux, de les rénover, d’améliorer leur urbanisme, d’y attirer des investisseurs pour les réintégrer dans le cadre ordinaire de la ville. Nécessaire, cette l’est sans doute, mais si elle était suffisante, cela se constaterait ! Pour comprendre les raisons de cette insuffisance, il faut alors se demander si cette déqualification des lieux constitue bien la cause du problème des banlieues…ou si elle ne constitue pas plutôt la conséquence d’une déconnexion de ces quartiers d’avec la ville. Auquel cas, la solution passe tout aussi nécessairement par le rétablissement méthodique des connexions entre ces quartiers et la ville, par une remise en mouvement de leur population. Le second postulat concerne la manière d’aborder ladite population. S’adresser à celle-ci comme si elle était composée uniquement d’individus ayant à faire un choix entre les chances qu’on leur offre « d’en sortir »et la menace d’une sanction accrue des pratiques marginales et des trafics illégaux qui constituent une partie des ressources de ces quartiers, n’est-ce pas faire l’impasse sur l’effet de stigmatisation globale qui affecte leurs habitants ? Non, bien sûr, que cette sommation d’avoir à choisir entre une démarche d’insertion et de délinquance soit illégitime. Mais a-t-elle une chance de produire des résultats conséquents s’il n’y a pas d’abord un relèvement général de la population qui y habite, une stratégie de rétablissement de l’estime de soi et des autres dans ces lieux où tout concourt à ce qu’elle soit en chute libre ? Sans prise en compte de cette dimension collective de la « relégation » dans les cités sociales, l’action en direction des gens apparaît comme une manière de faire purement symbolique, comme une façon d’extraire une pincée d’élèves ou d’apprentis méritants qui justifieront le rejet des autres plus qu’ils ne leur serviront d’exemples, de figures probantes d’une réussite possible de tous. C’est à montrer la fausseté de ces deux postulats qui sous-tendent la politique de la ville dans sa configuration actuelle que l’on voudrait s’employer maintenant. Donner à voir comment la détérioration des lieux n’est qu’une conséquence de leur déconnexion et non leur cause, que c’est donc celle-ci qu’il faut viser et , pour cela, adopter une démarche qui table d’abord sur le collectif, sur la force qu’il peut procurer aux individus afin qu’ils saisissent leur chance au lieu de n’y voir qu’une duperie.
* * *
Pourquoi, d’abord, mettre ainsi l’accent sur le mouvement, sur la connectivité, plutôt que sur les lieux ? Parce que la ville a changé depuis un demi-siècle et que ce changement revient justement à faire prédominer les flux sur les lieux alors que c’était l’inverse au moment où furent construites ces fameuses cités sociales qui se trouvent au cœur de la politique en question.
L’urbanisme fonctionnel de l’ère industrielle avait été conçu contre « les méfaits de la ville », contre « l’attraction néfaste » que celle-ci exerçait sur la population qui venait s’y concentrer, séduite par ses lumières et ses emplois, mais que la cherté conséquente des loyers conduisait à l’entassement, à la démoralisation et rendait prompte à l’émeute. Pour contenir cette attraction, on avait séparé les fonctions, isolant celle de l’habitat par rapport à celle de l’activité industrielle et celle du commerce. Pour stabiliser les salariés, on avait inventé la cité sociale, ce lieu où chaque famille pouvait satisfaire ses besoins dans un cadre propre à réduire le rôle des inégalités de revenu entre les habitants grâce à l’uniformité de l’habitat. La citoyenneté sociale proclamée au milieu du XXe siècle avait partie liée avec cette figure de la ville, ou plutôt cette anti-ville tant la cité sociale procède d’une véritable urbaphobie. Grâce à cet urbanisme fonctionnel, les lieux prédominent sur les flux. Ils sont lestés chacun d’une fonction bien précise qui arrime les individus à distance convenable de l’emploi comme des lieux de commerce et de loisir. On ne se déplace qu’autant que l’on change de fonction. Les trajets sont bien balisés et les travailleurs stabilisés, installés durablement à une distance calculée de la manufacture où doit s’écouler l’essentiel de son existence professionnelle.
Nous vivons, à présent, dans un tout autre modèle urbain, celui de la ville des flux de l’ère de la globalisation. Un lieu n’y vaut plus tant pour lui-même qu’en tant que support de mobilités vers des ailleurs plus ou moins lointains, comme le disent les géographes de l’urbain. (cf en particulier les analyses de Christophe Demazière) Cela explique la revalorisation des centres qui permettent de relier la multiplicité des flux de toutes sortes, de fertiliser ces lieux par l’effet de leurs croisements. Cela permet aussi bien de comprendre que plus l’on maîtrise l’accès aux flux, plus l’on peut choisir librement son lieu de vie, élire celui qui offrira le plus d’aménités en évitant les compagnies indésirables. Le périurbain se développe ainsi selon une logique de « clubbisation » (formule d’Eric Charmes) qui répartit les habitants dans des ensembles distincts à raison de leurs affinités sociales. Par contre, plus les lieux sont subis, plus ils deviennent synonymes de relégation. Cela vaut pour les périphéries lointaines mais aussi et plus encore pour les anciennes cités proches du centre mais privés de contact avec lui et devenant problématiques à raison de cette déconnexion. La pauvreté des contacts avec le dehors y facilite les flux illicites, l’insécurité et la dégradation. Le problème de la citoyenneté n’y est plus que secondairement social. Il découle surtout, à présent, du contraste entre les espaces branchés sur la ville des flux et ceux dont les habitants se trouvent déconnectés de la ville. Il devient urbain. En ce sens, la relégation n’est pas à attribuer à une erreur d’urbanisme, à une symbolique néfaste des tours et des barres (même si elles y contribuent passablement), ni même à un désinvestissement des lieux par les entrepreneurs (sinon la Seine Saint Denis serait un département sans problème compte tenu des entreprises qui s’y sont installés à raison des avantages qui leur ont été accordés par les politiques, mais dont les employés viennent des départements voisins). Elle est le produit d’une transformation de la logique organisatrice de la ville, de cette redistribution de l’habitat de chacun de façon à ce qu’il dispose d’un accès aussi aisé que possible aux opportunités d’emploi, de scolarité et de formation ainsi que d’un cadre de vie choisi, d’un environnement physique et social offrant les meilleures aménités et permettant d’éviter les rencontres « dérangeantes ». Ainsi, le ghetto commence là où la logique de club cesse de faire effet, là où la part du choix disparaît au profit du subi. Mais on peut aussi bien dire l’inverse : que la logique de club s’enclenche dès que l’on sort du ghetto, de cet environnement subi, et que l’on peut s’offrir un habitat qui fournisse pour les moyens dont on dispose le meilleur rapport entre accès à l’emploi et qualité sociale de l’environnement. De toutes façons, le problème du ghetto découle de ce que tout y est subi, qu’ils n’on pas de prise sur leur environnement ni d’accès véritable aux opportunités de la ville.
* * *
Comment rétablir la connexion entre ces quartiers défavorisés et la ville des flux ? La question se pose dans la plupart des pays européens depuis les années soixante-dix. Les réponses différent selon les pays et évoluent avec les changements de gouvernements d’une manière suffisamment nette pour que l’on puisse établir une distinction assez claire entre une voie de droite et une voie de gauche, même si un mélange s’opère au fil du temps. Mais l’important se situe justement dans la manière de faire prévaloir l’une ou l’autre de ces deux directions puisqu’aucune ne s’est affirmé exclusivement. Evoquer ces deux tendances à l’échelle européenne peut aider à comprendre où nous en sommes, en France, sur ce sujet avec la politique de Nicolas Sarkozy.
Une première voie, celle que l’on dira de droite, s’est s’imposée comme une évidence. Elle consiste à dire : pour effacer cette coupure, faisons pénétrer la ville dans ces quartiers, rétablissons-y les règles de respect des autres et de l’environnement. Et, comme le respect de ces règles parait le plus faible dans les quartiers d’habitat social, c’est le statut social de la propriété qu’il convient de limiter. Quand les gens sont propriétaires, ils se soucient beaucoup plus de la qualité de leur environnement car celui-ci retentit sur la valeur de leur bien. Diffusons donc autant que possible le statut de propriétaire parmi les habitants des cités sociales. Ou bien, introduisons dans ces quartiers des membres des classes moyennes à la faveur de constructions nouvelles, attractives par leur prix, afin qu’ils donnent le ton aux autres habitants. On peut désigner cette voie comme étant celle de « la responsabilisation ». Elle ne se limite d’ailleurs pas à la seule promotion de l’accès à la propriété mais peut désigner toutes les formes de responsabilisation de l’individu envers le collectif auquel il appartient à travers une forme de récompense financière plus ou moins manifeste.
Comme illustration de cette variété des formules de responsabilisation, on peut prendre un exemple bien connu des spécialistes de ces politiques : celui du programme Gold Service mis en œuvre par un bailleur social de Manchester, la Irwell valey housing association. Pour enrayer le déclin d’un quartier d’habitat social, ses gestionnaires eurent l’idée de proposer une récompense aux « bons voisins ». Sont désignés ainsi les locataires qui paient leurs loyers en temps et en heure et dont personne ne se plaint dans leur entourage. La récompense consiste en un service plus rapide pour les réparations d’appareil défectueux mais aussi l’attribution d’un crédit pouvant être dépensé dans les magasins de la région qui soutiennent la démarche ainsi que d’une somme dont le montant peut être doublé si les destinataires acceptent de le mettre au service de l’amélioration de la vie sociale de leur quartier.
Cette voie de la responsabilisation s’est d’abord affirmée en Grande Bretagne, sous Margaret Thatcher. Laquelle a inventé la formule du right to buy qui permettait aux locataires des logements sociaux d’acheter à un prix relativement bas le logement qu’ils occupaient. Un quart des logements sociaux furent ainsi vendus à leurs habitants. Elle a été suivie dans cette direction par Helmut Kohl, mais aussi, dans une moindre mesure, en Hollande et en France. Le même raisonnement se retrouve dans la politique de mixité de l’habitat prônée, en France, à travers la rénovation urbaine. Mais cette voie a montré assez vite ses limites : une plus grande concentration de la pauvreté dans le parc restant du logement social en Grande-Bretagne, une manière, en France, de nuancer la relégation plutôt que de la supprimer.
A raison des limitations rencontrées par cette voie de la responsabilisation, une autre voie s’est développée, depuis les années 90, en Grande-Bretagne et en Europe du Nord, assez peu en France où elle parait restée dans les limbes. Elle consiste à rechercher la connexion entre la ville et ces quartiers en partant de ceux-ci, par une démarche de restitution à leurs habitants de ce pouvoir qu’ils ont visiblement perdu sur leur territoire, leur cadre de vie, par une manière de tramer entre eux et les forces du dehors les liens nécessaires pour qu’ils profitent des opportunités de la ville. Cette voie peut être désignée comme celle de « l’empowerment » : élévation du pouvoir des gens sur leur vie, sur leur avenir. Elle se distingue de la précédente par l’accent qu’elle met sur le collectif. Puisque ne restent dans ces quartiers que ceux qui n’ont pas pu le quitter, elle porte à faire de cette incapacité de chacun séparément le ressort d’une force commune pour combattre l’installation dans une sous-citoyenneté à chacun des niveaux où celle-ci se fait sentir : civil, politique et social.
Comment permettre aux habitants de se réapproprier l’espace commun ? Suffit-il d’y faire circuler des unités de police, fussent-elles dites de quartier ? Avec celles-ci, les habitants gagnent en sécurité et le disent mais pas vraiment en liberté puisqu’ils restent prisonniers du conflit entre ces policiers et les jeunes qui les prennent à témoin de l’effet de harcèlement des contrôles qu’ils subissent. La solution à ce malaise dépend, selon la voie de l’empowerment, de la décision des policiers de considérer qu’il est aussi de leur devoir de rendre compte aux habitants, et de manière régulière, de leurs activités, de leurs méthodes et de leurs résultats. Seul ce dialogue peut apporter le respect en plus de l’ordre et la capacité pour les habitants de se donner à voir et à entendre dans l’espace public.
Que faire pour redonner une dignité politique aux gens qui s’estiment déconsidérés par le seul fait d’habiter dans ces quartiers de relégation ? Les inviter à participer à la mise en œuvre des politiques concernant leur habitat et leur environnement ? Oui, mais ce mot de participation recouvre tant de faux semblants qu’il est devenu à peine prononçable. Il ne peut retrouver une crédibilité que s’il permet d’influer sur l’emploi des crédits destinés spécifiquement à leurs quartiers en tant que ceux-ci pâtissent d’un préjudice particulier. La dotation de solidarité urbaine (DSU) est officiellement attribuée aux communes « à raison de l’évident déficit de la qualité de vie » offerte aux habitants dans certains quartiers. Reconnaître ce préjudice ne justifierait-il pas que soit accordé à ceux-ci un droit de peser sur l’usage de cette dotation dans le cadre d’un partenariat les réunissant avec les élus, les bailleurs et les prestataires de service ?
Comment lutter contre les effets de la ségrégation urbaine en matière de scolarité et d’emploi? Plutôt que se contenter d’arracher quelques jeunes à ces quartiers, mieux vaudrait tramer des liens méthodiques entre ces derniers et les opportunités présentes dans la ville, en termes d’emploi et de formation. Faire travailler ensemble les représentants de toutes les composantes de ces quartiers avec les responsables universitaires et les entrepreneurs, afin qu’ils mettent en place des parcours réalistes conduisant de la scolarité à l’emploi peut constituer le moyen d’une confiance retrouvée pour les habitants au niveau collectif parce qu’ils se verront effectivement reliés à la ville (comme le programme anglais aimhigher qui signifie littéralement : viser plus haut).
* * *
Entre ces deux voies - responsabilisation et empowerment – Tout le problème est de trouver le meilleur équilibre, celui qui ajustera au mieux les avantages de l’avoir individuel et ceux qui résultent du pouvoir collectif. Soit un souci qui a déjà présidé à chacune des déclinaisons –civile, politique et sociale- de la citoyenneté. Que signifie, en effet, l’avènement du suffrage universel, au XIX, sinon la nécessité de doter ceux qui ne disposent pas de l’avoir nécessaire pour échanger et s’exprimer d’un pouvoir de le faire en tant que sujets souverains, sauf à voir se perpétuer la violence émeutière. Et celle-ci joue bien le même rôle dans l’affirmation progressive de la citoyenneté sociale au milieu du XX. Les droits sociaux fournissent alors un pouvoir aux salariés contre les méfaits de la domination industrielle que la seule citoyenneté politique ne permettait pas de régler. C’est bien le même déséquilibre qui réapparait à la fin du XX avec les violences urbaines quand les droits sociaux ne suffisent plus pour intégrer une société où l’appartenance passe par l’aptitude aux connexions, par la disposition d’un capital social élargi alors que ceux qui le maîtrisent semblent portés à en restreindre le bénéfice pour leur seul usage. On peut alors étendre cet usage à la part « méritante » de ceux qui en sont exclus. Ou bien redonner les moyens d’une dynamique à l’ensemble de ceux-ci. Les deux démarches sont objectivement complémentaires mais produisent des effets sensiblement différents selon que l’équilibre s’opère au bénéfice de la première ou de la seconde de ces voies. Dans le premier cas, les rares bénéficiaires servent de justification à une dénonciation des autres. Tandis que, dans le second cas, ils apparaissent comme la récompense d’un effort partagé pour surmonter les fractures de la société urbaine. N’est-ce pas ainsi que se perpétue, au fil du temps, la distinction entre droite et gauche ?