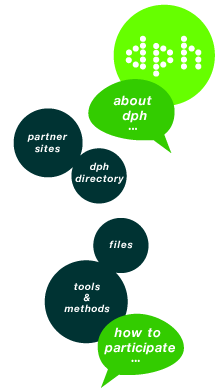Parce qu’on ne saurait traiter du dialogue interculturel sans évoquer la notion même de culture et parce qu’on ne saurait s’en tenir à une définition unique, tour d’horizon de la culture, des définitions que l’on en donne et de l’usage que l’on en fait.
S’il est une notion malmenée, c’est bien celle de culture. Il y a ce que l’on en dit – les définitions sont légions, fondées alternativement sur le patrimoine historique et intellectuel, les habitudes acquises, ou l’appartenance – et il y a ce que l’on en fait. On peut en faire une marchandise, ou un objet de musée (préserver les cultures autochtones des attaques de la mondialisation). On peut en faire une arme (« Vous manipulez à tout bout de champ un mot virtuel, me disait récemment un Indien, vous mettez la culture sur un piédestal. Mais dans le Maharashtra, la culture c’est l’oppression, l’outil exploité par les hautes castes pour asservir les plus basses ! »). On peut aussi la cantonner au folklore, comme le font ces expatriés qui adoptent et vantent les aspects culturels les plus apparents du pays d’accueil, apprennent quelques bribes de la langue pour s’en sortir avec les chauffeurs de taxi, font des fêtes « à la locale », mais qui continuent d’imposer leurs propres méthodes de travail et leurs propres rythmes en oubliant que la culture n’est pas que couleurs, sons et saveurs, mais aussi et surtout modes de faire, modes de pensée.
Mais ces modes de pensée-là sont en perpétuelle évolution. On ne peut plus considérer une culture en dehors de ses relations avec les autres cultures, de sa propre évolution, de son hybridation. Jamais statiques, les cultures sont le produit d’influences réciproques, de phénomènes d’acculturation : lorsque l’on se soucie aujourd’hui de lire la culture de l’autre, on retrouve forcément le résultat de croisements et l’on va probablement lire aussi quelque chose de sa propre culture. La culture est un phénomène vivant, indissociable des interactions entre aires géographiques différentes, de cet « interculturel » qui n’est pas qu’un fait, mais aussi un art, un cheminement, et même un moyen de produire de la culture nouvelle. Nulle part les cultures ne sont isolées, coupées de l’influence des autres, pas plus qu’elles ne sont désormais homogènes (l’ont-elles jamais été ?) ; toutes nos sociétés ou presque sont devenues pluriculturelles. Dès lors, la donne interculturelle est au cœur d’une multitude de pratiques professionnelles, et de tout engagement citoyen dans le contexte de la mondialisation. Pour autant, face à cette donne, les attitudes sont loin d’être les mêmes.
Attitudes face à la diversité
La diversité est parfois un alibi. Qu’un conflit survienne entre deux individus ou deux groupes, et aussitôt « on est dans l’interculturel », ce qui évite de régler les problèmes. Or à tous les niveaux, du local au mondial, la société fonctionne aussi en « tuyaux d’orgues », en filières dans lesquelles des hauts fonctionnaires de Los Angeles et de Bombay, élevés sur les mêmes bancs des mêmes écoles de management public, porteurs des mêmes références, peuvent agir comme des clones, tout en étant dans l’ignorance des réalités des quartiers chauds et des slums. Ainsi, l’idée toute faite qu’un Chinois et un Français ont forcément plus de difficultés à se comprendre que deux Français entre eux est souvent contredite par la réalité des situations socioprofessionnelles en présence. Il y a peut-être moins de différence culturelle entre deux neuropsychiatres italien et thaïlandais que, en France même, entre un sociologue et un technico-commercial.
Cependant, à l’inverse de ceux qui en abusent, beaucoup restent naturellement fermés à la problématique interculturelle, peu curieux des fondements et des logiques de la culture de l’autre, peu portés au doute. Il m’est souvent arrivé d’entendre des représentants du monde des affaires affirmer que le choix du pays où l’on travaille est « secondaire » !
Dans une vieille légende chinoise, un poisson demande à un crapaud de lui raconter la terre ferme. Le crapaud explique longuement la vie sur terre et dans les airs, les oiseaux, les sacs de riz, les charrettes. A la fin, le poisson s’écrie : « Drôles de poissons, dans ton pays ! Il y a des poissons qui volent, des grains de poisson qui sont mis dans des sacs, et on les transporte sur des poissons qui sont montés sur quatre roues ! » Autrement dit, lorsque nous essayons de comprendre une culture qui n’est pas la nôtre, notre tendance naturelle est d’y opérer des tris, de la disséquer et de la décrire suivant nos propres références. C’est un réflexe généralement inconscient – Heidegger remarquait que l’objet que l’on voit le plus mal, c’est la paire de lunettes que l’on porte devant les yeux – mais c’est un réflexe lourd de conséquences dès lors que lire le monde suivant nos critères, nos méthodes, nos habitudes nous amène à vouloir l’y conformer.
Nous partons souvent à l’étranger avec notre kit de certitudes, notre panoplie de méthodes, d’évidences, de prétention parfois, de générosité souvent, sans nous poser la question de savoir si ces évidences sont aussi celles de ceux chez qui nous nous installons, et si cette générosité, souvent assortie d’une extrême impatience, est bien ce que l’on nous demande. Formatés par notre culture d’origine, notre métier ou notre éducation, nous ne sommes pas, ou peu, sensibilisés à ce défi de l’altérité cher à Emmanuel Levinas qui en fit plus qu’un constat, un principe : reconnaître de l’autre dans sa différence, passer du stade du « ils sont fous ces gens-là » au stade du « nous nous étions mal compris ».
La difficulté à sortir de soi, la propension à privilégier le groupe humain auquel on appartient et à ne pas imaginer qu’il y ait d’autres modèles de référence, c’est l’ethnocentrisme, qui consiste à ériger, de manière indue, les valeurs propres à la société à laquelle nous appartenons en valeurs universelles (1). Il ne s’agit par-là forcément d’une stratégie, d’une attitude consciente de domination ; c’est pire. C’est la conviction profonde, indéracinable qu’il n’y a pas de meilleure façon de penser que la nôtre.
La vitalité du nombrilisme
Cette conviction a des racines historiques, symboliques et philosophiques très profondes, dont on voit le signe – ce n’est pas qu’anecdotique – dans la dénomination même de certaines villes du monde : Cuzco, capitale de l’Empire inca, signifie « nombril », Pékin reste pour beaucoup la capitale de l’« Empire du Milieu », les Egyptiens continuent à dire du Caire qu’elle est « la mère du monde ». La Mecque, Delphes et bien d’autres sont des villes qui, à un moment donné de l’Histoire, se sont pensées au centre, capitale non pas d’un empire parmi d’autres, mais de l’Empire. L’Occident, quant à lui, est loin d’avoir le monopole du nombrilisme. Mais il est chargé d’une tradition complémentaire qui explique l’origine de beaucoup de nos réflexes : une tradition « universaliste » militante, qui est à la fois religieuse (porter l’évangile aux nations) et rationaliste (après le siècle des Lumières). L’universaliste a la certitude qu’il existe des valeurs absolues, valables pour tous car inhérentes à la nature humaine, indiscutables, et il estime naturel de les imposer là où on les refuse encore.
A l’opposé, une posture courante aujourd’hui est celle du « relativisme culturel » qui professe que les différences entre les cultures sont irréductibles, que les cultures forment des entités impossibles à comparer et que, somme toute, « toutes les cultures se valent », position qui interdit le jugement et la hiérarchisation des cultures, et que l’on assimile souvent à tort à la tolérance. Car la tolérance peut être jugement aussi : « tolérer » la culture de l’autre ne sous-entend-il pas qu’en fait on la désapprouve ?
Ni universaliste ni relativiste, je plaide quant à moi pour une posture de vigilance et de curiosité, la recherche d’une « intelligence de l’autre », la prise de conscience de la multiplicité des causes profondes – historiques, linguistiques, religieuses, philosophiques – des malentendus interculturels qui ne manquent jamais de surgir dans nos relations partenariales avec les autres continents ou au sein même de nos pays pluriels. Au « L’enfer, c’est les autres » de Sartre, je préfèrerais la formule : l’enfer, c’est refuser que l’autre soit autre. Non pour le fétichisme de l’altérité. Mais parce que, dans un monde que nous sommes aujourd’hui contraints, pour des raisons économiques, sociales, environnementales, de gérer en commun, il est essentiel de prendre en compte les différences culturelles, non comme un handicap, mais comme un possible atout.
Key words
cultural diversity, cross cultural dialogue
file
L’impossible dialogue des cultures ?
Comments
Michel Sauquet travaille depuis une trentaine d’années dans le secteur de la coopération internationale. C’est de ce vécu, nourri de nombreuses expériences de terrain, qu’il est parti pour rédiger « L’intelligence de l’autre », un livre riche, simple, clair et pédagogique qui apporte une réflexion sur la différence, les malentendus culturels, l’enjeu de l’identification de terrains d’entente. Il propose par là, à ceux qui, dans l’humanitaire, dans l’entreprise, dans les organisations internationales, sont amenés à travailler ou à vivre dans des cultures qui ne sont pas les leurs, un réflexe de questionnement de la culture de l’autre et une prise de conscience du conditionnement culturel qui habite tout un chacun.
L’intelligence de l’autre – Prendre en compte les différences culturelles dans un monde à gérer en commun, Michel Sauquet, en collaboration avec Martin Vielajus, Editions Charles Léopold Mayer, 2007, 330 p.
Source
Altermondes n°16 - décembre 2008 > février 2009, www.altermondes.org (Revue trimestrielle de solidarité internationale)

IRG (Institut de recherche et de débat sur la gouvernance) - France - www.institut-gouvernance.org - info (@) institut-gouvernance.org