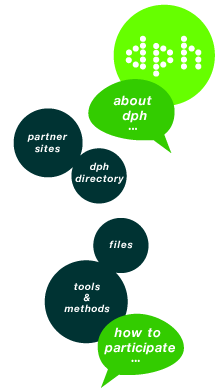L’humanité s’inflige à elle-même de nouvelles plaies qui, pour la première fois et contrairement aux sept plaies d’Égypte, ne sont ni naturelles ni divines : accidents technologiques majeurs, instrumentalisation du vivant, menaces de terrorisme à coup d’armes de destruction massive, réchauffement climatique, etc. Dans toutes ces catastrophes annoncées, mais non imparables, l’humanité a une responsabilité centrale. En philosophe et historien des sciences, Jean-Jacques Salomon nous ouvre ici les pistes dont chacun peut se prévaloir pour prendre la mesure des périls auxquels le XXIe siècle confronte l’humanité. Loin de la fin de l’histoire ou de tout déterminisme technologique, il fait la démonstration du possible, de l’urgence et de la nécessité d’une action concertée à l’échelle de la planète.
L’ouvrage « Une civilisation à hauts risques » est téléchargeable en ligne, sur le site des ECLM : http://www.eclm.fr/…
Introduction
La chute du mur de Berlin a donné à croire – pas très longtemps – qu’un monde voué à la paix, au désarmement, à la réduction planétaire des tensions et des inégalités était à portée de mains (1). Le philosophe américain d’origine japonaise, Francis Fukuyama, disciple d’Alexandre Kojève lui-même grand lecteur de Hegel, annonçait avec le plus grand sérieux la fin de l’histoire: le communisme effondré et partout hors jeu, sauf encore à Cuba et en Corée du Nord – la Chine et le Vietnam devenant un étrange mixte de bureaucratie totalitaire et d’ouverture au marché international –, l’économie libérale s’étendrait triomphalement à l’ensemble de la terre pour surmonter toute tentation de violence interétatique (2). L’alignement des économies, le «doux commerce» tant vanté par Montesquieu comme facteur irrésistible de paix et de démocratie, le refus collectif des prétentions nietzschéennes du «surhomme» à dominer le monde, tout devait concourir à libérer définitivement l’humanité de la peur, à l’affranchir des dangers, des servitudes et des crimes auxquels les passions nationalistes et/ou révolutionnaires l’avaient exposée au cours du XXe siècle.
L’utopie – ou la naïveté – du thème de la fin de l’histoire n’a pas résisté au choc de trois facteurs qui ont marqué le passage du XXe au nouveau siècle: le retour des rivalités, des surenchères nationalistes et des massacres ethniques, dont même l’Europe, avec l’explosion de l’ex-Yougoslavie, a été le théâtre; la montée en puissance des fondamentalismes et du terrorisme mondialisé ; le réchauffement du climat et la menace de l’épuisement des ressources non renouvelables. Fukuyama imaginait avec sa vision du « dernier homme » embourgeoisé suivant Nietzsche, symbole anti-héros de la planétarisation des classes moyennes, le règne de la médiocrité sous l’oriflamme du libéralisme triomphant – un règne cependant dynamisé par l’influence dominatrice de la culture et des pratiques de gestion inspirées par les États-Unis.
Assurément, le modèle impérial des États-Unis privés d’un adversaire à leur taille a fait croire à l’avènement d’une pax americana capable de maîtriser, comme Rome avait su y parvenir pendant des siècles, toutes les sources de tensions, sociales, religieuses ou politiques. Mais l’illusion des dividendes de la paix à exploiter au lendemain de l’implosion du communisme n’a pas duré : c’est qu’elle a occulté, comme un cache-misère, la nature nouvelle des risques qui, en fait, avaient émergé et s’étaient multipliés dans les replis cachés de la croissance économique que le monde, et en premier lieu le monde occidental, avait connue à la faveur même de la compétition opposant les deux blocs de l’Ouest et de l’Est. Dans cette « lutte-concours », comme François Perroux l’avait définie, les surenchères stratégiques ont joué un rôle déterminant, contribuant à la fois à augmenter la puissance technologique des États-Unis et à rendre plus manifestement vulnérable le système soviétique.
On a oublié – déjà – les tensions, les invectives, les enjeux idéologiques qui ont présidé aux relations internationales durant la Guerre froide et surtout les risques mortels d’une confrontation nucléaire qui ont nourri les échanges entre les deux puissances bipolaires. Chacune regroupait et mobilisait son camp dans les incertitudes et les surenchères d’une course aux armements qui tendait à l’holocauste. L’OCDE, version économique à l’Ouest – « la conscience du capitalisme » disait Raymond Aron – dont l’OTAN était le fer de lance militaire, trouvait en face d’elle un COMECON qui se voulait la coalition économique des satellites du communisme, dont le pacte de Varsovie était tout autant la mobilisation en armes.
Rétrospectivement, on peut interpréter le fait que la lutte entre les deux camps n’ait pas conduit à une montée aux extrêmes soit comme une véritable chance résultant, malgré tout, de la rationalité manifestée par les deux adversaires, soit d’un choix stratégique aux termes duquel ceux-ci ont «joué» à se faire peur en sachant très consciemment qu’il n’était pas question de jamais passer à l’épreuve des armes nucléaires. Et l’on ne peut davantage exclure qu’ait joué, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la prise de conscience par les dirigeants qu’ils seraient eux-mêmes directement exposés au massacre; peur originale, si l’on peut dire, celle du chef d’État qui se dit qu’il est voué à être la première victime d’un bombardement atomique parfaitement ciblé. Cette dernière version peut tout aussi bien éclairer le recul de Khroutchev, quand Fidel Castro lui demanda de tirer sur la Floride ses missiles implantés à Cuba.
On comprend que l’économiste Galbraith, conseiller du président Kennedy, ait suggéré que les deux superpuissances simulaient la guerre par la compétition économique et technologique, notamment spatiale: «À peu de choses près, la désuétude est à la compétition technologique ce que l’usure est à la guerre (3). » J’avais moi-même insisté, à propos des coups d’accélération donnés aux efforts de recherche-développement, sur cette dimension de la Guerre froide en me référant à la thèse célèbre de Huyzinga: «La compétition technologique entre les pays les plus industrialisés correspond très exactement à la définition que Huyzinga donne de la guerre comme activité ludique et agonale, c’est-à-dire comme une épreuve où chacun s’efforce de l’emporter sur l’autre pour la gloire de le précéder plutôt que pour l’avantage de le réduire (4).»
Ce caractère de joute ludique ne pouvait pas néanmoins dissimuler l’ampleur sans précédent du risque couru par l’humanité si l’opposition radicale entre les deux systèmes débouchait sur le passage à l’acte nucléaire: on estimait à la fin des années 1980 les arsenaux de chaque côté entre 40 000 et 50 000 bombes thermonucléaires, soit de quoi largement éradiquer toute forme de civilisation (l’échange d’une grande quantité de missiles pourvus de multiples têtes nucléaires aurait eu des retombées radioactives sur toute la terre). Deux scorpions dans une bouteille, chacun sachant parfaitement que la moindre morsure à l’un entraînerait la liquidation de l’autre: la formule de Robert Oppenheimer, maître d’œuvre du programme Manhattan qui donna naissance aux premières bombes atomiques, celles qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki, illustre une fois pour toutes les enjeux et les limites de la stratégie de la dissuasion – une stratégie de déraison absolue comme la désignait le sigle américain MAD, «destruction mutuelle assurée». L’énormité et l’immoralité même de la menace ont joué le rôle d’un «répresseur de violence», comme l’a dit le général Poirier, grand théoricien de la stratégie nucléaire: les adversaires-partenaires devaient «agir et s’interdire d’agir dans un halo d’incertitudes partagées, mais génératrices de modération politique et de prudence stratégique dès lors que chacun savait au moins une chose: une erreur d’interprétation serait fatale à tous. Paradoxalement, ici, l’incertitude est créatrice d’ordre (5).»
C’est de cette menace de la montée aux extrêmes entre les deux superpuissances que la fin de la Guerre froide a donné le sentiment de libérer l’humanité, alors qu’au contraire elle introduisait dans les relations internationales de nouveaux facteurs de désordre : l’histoire redémarrait au galop avec des scénarios nouveaux. D’une part, le danger d’un conflit nucléaire n’est pas supprimé par l’effacement de la Guerre froide: en fait, plus que jamais, le problème posé par ce type d’armements devient plus complexe et plus difficile à maîtriser, la «prolifération» menaçant d’échapper au contrôle des puissances nucléaires officiellement «dotées», qui sont aussi membres permanents du Conseil de sécurité aux Nations unies.
L’existence (non prouvée) d’un armement atomique en Irak a été le prétexte de l’intervention américaine. L’Iran, signataire du traité de non-prolifération, cherche à se doter d’un tel armement, et la Corée du Sud, tout aussi signataire du traité, est désormais un pays «doté» non seulement de la bombe, mais aussi de fusées à très longue portée. L’un et l’autre ne montrent pas seulement la fragilité des accords internationaux si difficilement obtenus dans ce domaine, ils illustrent aussi l’intensité de la contestation dont les pays déjà «dotés» sont l’objet dans tous les pays en développement, que ceux-ci aspirent ou non à devenir puissances nucléaires. Une telle situation est d’autant plus hasardeuse que les pays officiellement membres du club atomique se sont gardés d’honorer leurs obligations en matière de désarmement nucléaire (6).
D’autre part, il faut désormais compter avec la menace d’actes terroristes utilisant des armes de destruction massive, nucléaires, biologiques ou chimiques, et la décomposition même du régime soviétique a fait craindre la possibilité de trafics et de piratages de produits radioactifs liés au démantèlement de ses missiles et sous-marins nucléaires. Le recours par des groupes terroristes sur le modèle d’Al Qaïda ou par ce que les États-Unis appellent des «États voyous» (rogues states) à des scientifiques devenus mercenaires n’est pas un scénario de science-fiction, comme l’ont illustré les transferts de technologies nucléaires à la Libye, à la Corée du Nord et à l’Iran par les soins d’Abdul Qadeer Khan, l’ingénieur qui a mis au point les missiles et les bombes pakistanaises, vendant ses secrets soit par conviction religieuse soit plus simplement par appât du gain.
Bien loin de consacrer la fin de l’histoire, l’attentat du 11 Septembre revendiqué par Al Qaïda a entraîné les interventions «unilatéralistes» des États-Unis ne répugnant pas à des guerres préventives ou préemptives. En fait, la chute du mur de Berlin et la fin du système soviétique ont ouvert des pages nouvelles dans le livre d’une histoire humaine dont on se demande comment – à moins de voir se réaliser le rêve kantien de la paix perpétuelle – elle échapperait à ses traditionnelles pulsions shakespeariennes de violences et de désordres.
Or le dernier quart du XXe siècle a aussi précipité la prise de conscience de nouveaux risques, non seulement les accidents technologiques «majeurs» tels ceux qui ont eu pour théâtre Minamata, Bophal ou Tchernobyl, mais encore ceux que la main de l’homme, le produit de son génie industriel et technologique, a installés au cœur même de la nature et dont l’échelle de temps et d’espace est sans équivalent avec les pires risques que la nature est capable de produire. Quelles qu’elles aient été, en effet, les conséquences des tremblements de terre, éruptions de volcans, raz de marée, cyclones, tempêtes ou gigantesques inondations, les risques et les grands accidents naturels ont toujours été localisés (y compris la chute d’une mégamétéorite et si vastes qu’aient pu être les territoires affectés). En revanche, le réchauffement du climat entraîne des conséquences d’ordre planétaire, imposant à la nature même et à toutes les espèces vivantes des perturbations dont l’accumulation et l’enchaînement constituent une menace de déstabilisation allant jusqu’à des menaces de mort pour l’humanité.
Dès 1955, John von Neumann s’était interrogé sur la contradiction – le conflit planétaire – entre l’évolution technique et la survie de l’humanité : la croissance démographique d’un côté et l’expansion industrielle de l’autre tendent ensemble à augmenter les prélèvements sur des ressources qui ne sont pas inépuisables et les rejets qui altèrent d’autant l’environnement (7). La contradiction est d’autant plus grande qu’elle souligne l’écart entre le morcellement politique du monde qui exclut l’unanimité au sein des Nations unies et la capacité croissante de la technique à l’affecter dans sa globalité. C’est de ce point de vue que le phénomène de la mondialisation est absolument nouveau, alors que les «économies-mondes», dont les réseaux sont depuis longtemps à l’échelle de la Terre, sont un très vieux phénomène inscrit dans la division la plus traditionnelle entre sociétés riches et sociétés pauvres – dominatrices et dominées. C’est un point sur lequel il faut insister pour sortir des mythologies de la mondialisation: les «économies-mondes» existent depuis qu’existent des États exerçant leur puissance à la faveur du capitalisme sur des sociétés ou des États dominés – et sans doute même avant le capitalisme, si l’on songe à ce qu’était l’Empire romain.
«L’environnement dans lequel le progrès technique doit se réaliser est devenu à la fois trop étroit et sous-organisé»: on voit bien comment ce diagnostic de von Neumann se traduit aujourd’hui simultanément par le refus de certains pays de sacrifier leur économie au bénéfice fût-ce du protocole de Kyoto et par l’aggravation des dommages causés à l’environnement. Le dogme du capitalisme industriel qui postule l’augmentation conjointe de la croissance et de la consommation a pour effet d’épuiser les ressources non renouvelables et d’altérer le milieu physique qui rend la vie possible : la menace revêt des formes nombreuses, qui vont de l’extinction de beaucoup d’espèces animales ou végétales à la pollution des mers, des fleuves et des nappes phréatiques, de la fonte des glaciers et donc de l’augmentation du niveau des océans à l’enrichissement de l’atmosphère en gaz à effet de serre et aux transformations climatiques que celui-ci promet de multiplier.
Il saute aux yeux – mais le bon sens n’est pas comme le voulait Descartes la chose la mieux partagée au monde – que seule une réduction des consommations d’énergie, importante, organisée, planifiée sur le long terme et coordonnée à l’échelle de l’ensemble des nations, est le meilleur moyen d’atteindre l’objectif d’une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Mais les relations interétatiques ne sont pas telles qu’un accord international soit à l’horizon: on verra comment «les leçons des ténèbres » qu’on peut tirer comme une étude de cas du conflit israélo-palestinien donnent une idée de l’indolence de ce qu’on appelle la gouvernance mondiale à imposer la paix, et il ne s’agit (encore) que d’un conflit régional, alors que l’enjeu planétaire des altérations climatiques est une perspective de catastrophes qui menace toute l’humanité. Maîtriser la demande d’énergie est un objectif sur lequel la plus grande partie des programmes électoraux entendent bien ne pas s’aligner, même si les rapports venus des milieux politiques, et non plus seulement scientifiques, commencent à montrer des signes de vive inquiétude.
Ainsi, en France, les rapports sur l’effet de serre des députés Jean-Yves Le Déaut (PS) et Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP) n’hésitent pas en 2006 à parler de «catastrophe climatique annoncée», tout comme les sénateurs Pierre Laffite (RDSE) et Claude Saunier (PS) soulignent dans le leur que les « conséquences du changement climatique sont très sous-estimées ». Mais sous-estimées par qui et pourquoi (8)? Tel est bien l’écart dénoncé par von Neumann entre les structures et les comportements politiques d’un côté, et de l’autre les réalités irrépressibles de l’évolution industrielle et des intérêts qu’elle met en jeu: les hommes d’État dont l’horizon n’est que le court terme ne voient dans ces rapports que raisons de tergiverser, alors qu’au «regard des modèles prédictifs antérieurs», dit le rapport des sénateurs, « ce sont à chaque ajustement par les experts les fourchettes hautes d’estimation qui se confirment. »
Al Gore, l’ancien vice-président des États-Unis battu de peu aux élections par George Bush Jr, avait fait de l’environnement le thème majeur de sa campagne ; le film documentaire qu’il a réalisé avec David Guggenheim, Une vérité qui dérange, a eu depuis plus de retentissement dans le monde entier. Les parlementaires français ont eu droit à une séance spéciale commentée par Al Gore en personne à l’Assemblée nationale, tout comme d’autres élus dans plusieurs autres pays, y compris la Chine: jusqu’à quel point ont-ils été convertis à l’idée que cette croisade devait devenir la leur?
Les progrès spectaculaires des technologies de l’information et de la communication ont donné à espérer un rapprochement entre les peuples, les nations, les cultures, mais l’on voit bien que le thème du «village global» cher à McLuhan est loin – très loin – d’entraîner les nations dites unies à célébrer d’un même chœur leur solidarité devant les confirmations de cette menace – sans parler même d’adhérer aux conclusions de la grande majorité des scientifiques, comme en témoignent l’équipe de George Bush Jr à la Maison Blanche et ses soutiens parlementaires au Congrès chez nombre de démocrates autant que chez les républicains. Ou en France l’ancien ministre de la Recherche, Claude Allègre, exprimant solennellement ses doutes, comme s’il était un spécialiste de la climatologie, sur les liens entre le réchauffement du climat et le processus d’industrialisation.
L’importance des intérêts en jeu, le poids des groupes de pression, l’indolence du personnel politique rivé aux échéances électorales expliquent que les décisions indispensables soient toujours reportées. Casser le thermomètre ou en édulcorer les données ne changera rien à la réalité de la fièvre, c’est pourtant le spectacle que donne le pays qui représente 30 pour cent des émissions de carbone par habitant, record assurément mondial. Aucun exemple ne montre mieux que celui-là le poids qu’exercent les multiples lobbies de l’énergie (alliés en l’occurrence des milieux néo-conservateurs) sur les décisions politiques, en fait sur le refus de décisions qui tiendraient compte des conclusions auxquelles est parvenu le Groupe intergouvernemental sur le changement climatique (GICC en français, IPCC en anglais), qui réunit sous les auspices des Nations unies plus de 4 000 scientifiques spécialistes du climat et de l’environnement.
Il n’y a d’ailleurs pas que la contestation des conclusions de l’IPCC par des commentateurs manifestement aux ordres ou manipulés par des lobbies, sous forme notamment de fausses démonstrations scientifiques multipliées dans des publications et des émissions de télévision largement subventionnées, pour diffuser dans l’opinion l’idée que, puisqu’il y a débat et parfois désaccord entre les scientifiques, les choses peuvent continuer comme devant sans dommage (business as usual). Il faut encore mentionner l’intervention des instances politiques sur des résultats acquis par les enquêtes scientifiques: par exemple aux États-Unis, certains rapports des spécialistes, y compris ceux de la National Academy of Sciences, reviennent censurés par la Maison Blanche dès lors qu’ils accordent trop de crédit aux menaces du réchauffement du climat. Et dans un pays qui se veut démocratique, qui s’est à peine remis de l’expérience de la chasse aux sorcières sous le maccarthysme, on est stupéfait de voir un scientifique incontesté présenter son compte-rendu de livres consacrés à ces enjeux par la mise en garde suivante: «Jim Hansen est directeur de l’Institut Goddard de la NASA pour les études spatiales et professeur adjoint de sciences de la terre et de l’environnement à l’université Columbia. Ses opinions sont ici exprimées en tant que vues personnelles sous la protection du 1er Amendement de la Constitution des États-Unis » (celui qui protège la liberté d’opinion) (9).
Autrement dit, dans le contexte des convictions de la Maison Blanche résolument opposées au protocole de Kyoto, prévoir et rendre publics les dégâts de l’altération radicale de l’environnement sous l’effet du processus industriel donne le sentiment de s’exposer à des poursuites pour propos et menées anti-américains! Tel est bien le cas de Jim Hansen, qui n’hésite pas à annoncer que si rien n’est fait pour réduire d’ici un siècle les émissions de carbone, de méthane et d’ozone à la source de la menace de changement climatique, le réchauffement du climat (de 3 à 5 degrés) peut entraîner une élévation du niveau des mers de près de 2,5 mètres, c’est-à-dire «anéantir des villes sur la côte Est telles que Boston, New York, Philadelphie, Washington et Miami, et submerger pratiquement tout l’État de la Floride sous les eaux. Quinze millions de personnes vivent aux États-Unis en dessous de ce niveau de la mer. »
On voit à quels obstacles d’ordre économique, politique et idéologique s’oppose la nécessité pourtant de plus en plus évidente de mesures visant à réduire, autant que faire se peut et dès maintenant, les facteurs de déstabilisation du climat. Si rien n’est fait hic et nunc à l’échelle qui s’impose, ce n’est pas seulement la situation qui a toute chance d’empirer, c’est surtout qu’à un certain niveau de dégâts le processus a des effets irréversibles et devient impossible à maîtriser. À moins de réduire drastiquement les émissions de carbone et de savoir les capturer pour les séquestrer sous terre, l’accroissement de 2 pour cent par an de ces émissions au cours de la dernière décennie représenterait pendant la nouvelle décennie 35 pour cent de plus en 2015 qu’en 2000 (10). L’histoire de la terre a déjà connu des augmentations moyennes de chaleur de 5 à 10 degrés, entraînant la disparition de 50 à 90 pour cent des espèces. Par exemple, la plus récente de ces périodes d’extinctions de masse remonte au Paléocène et à l’Éocène: la vie y a certes continué, assurant l’apparition de nouvelles espèces (les mammifères notamment, des rongeurs aux primates), mais suivant un processus qui a pris des centaines de milliers d’années.
Le thème même de la mondialisation devrait alerter davantage sur les conséquences irréversibles du processus d’industrialisation : d’un côté, une croissance non maîtrisée et peut-être non maîtrisable des asymétries au sein d’un système international qu’on s’est trop hâté de prétendre «globalisé», à plus forte raison «pacifié»; de l’autre, le passage du risque naturel au risque technologique majeur, qui introduit une dimension absolument nouvelle dans les répercussions de l’activité humaine ; et de plus la croissance démographique qui ne peut que rendre plus dramatique la situation sanitaire et alimentaire d’une grande partie des pays en développement; enfin, les dégradations de l’environnement qui se traduiront fatalement par d’immenses mouvements migratoires de populations et des heurts entre nations à propos des ressources naturelles, pétrole et gaz, air et eau. Les batailles pour l’énergie ont mobilisé l’histoire du capitalisme industriel, la nouveauté sera la multiplication des conflits à propos de ressources considérées jusque-là par les pays industrialisés comme accessibles et disponibles à bas prix. On peut vivre sans pétrole, on ne peut survivre sans eau. La pénurie d’eau ne peut que multiplier et aggraver tensions et confrontations, avec des migrations massives et des pressions exercées sur ceux des pays pour lesquels l’eau est au contraire, comme pour le Canada, une abondante richesse naturelle (11)1.
À quoi il faut ajouter les menaces de terrorisme à coups d’armes de destruction massive, que facilite le processus même de la mondialisation sous ses aspects strictement techniques (Internet, téléphones portables, transports aériens, liaisons électroniques bancaires pour le blanchiment d’argent, etc.). C’est toute la nouveauté du XXIe siècle, dont la mondialisation pourtant n’est pas tant nouvelle que la nature des risques auxquels s’expose la civilisation même.
On parle des «sociétés du savoir» comme s’il suffisait de s’appuyer sur l’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour généraliser à travers la planète un même capital de connaissances et de compétences. Vers les sociétés du savoir est le titre d’un rapport de l’Unesco qui tend à montrer que la mondialisation doit se traduire par l’accès de tous les peuples et de tous les États à la même capacité de maîtrise de ces technologies. Comment ne pas applaudir à un tel objectif qui, s’il pouvait être atteint, réduirait toutes les raisons de ressentiment et de haine qui parcourent dans les pays en développement des générations de millions de jeunes gens sans formation ni emploi ? L’image du bien-être des pays dits riches, de leur confort, de leur niveau de consommation et de leurs fantasmes de toutes sortes que véhiculent leurs centaines de chaînes télévisées dans le monde entier, illustre l’ampleur des asymétries qui sont manifestement à la source des envies, des rancœurs et des diabolisations qui font et pétrissent la pâte des tensions et des conflits d’aujourd’hui.
C’est pourtant négliger deux choses qui interdisent de renouveler l’utopie du siècle des Lumières revenant à professer que le progrès de la science et de la technique débouche irrésistiblement sur le progrès social et même moral, à terme sur l’entente et la paix entre les peuples. D’une part, mondialisation ne signifie pas uniformisation des aptitudes et des compétences, d’autant moins que demeurent d’importantes asymétries au sein même des sociétés industrialisées, qui ne peuvent qu’exacerber les tensions; on le voit bien avec le problème de l’immigration. D’autre part et surtout, l’évolution du processus d’industrialisation confronte l’humanité à des risques sans précédent, que ces asymétries promettent encore de rendre plus dramatiques. Le XXIe siècle doit affronter un paradoxe qu’illustre précisément la multiplicité des nouveaux risques auxquels l’avenir même de l’humanité est désormais suspendu: c’est que, si fières qu’elles soient de leurs exploits scientifiques et techniques, les sociétés du savoir portent aussi en elles, grâce à la science et à la technologie, les ferments et les germes de leur destruction (12).
* **
Il n’est sans doute pas inutile, pour donner tout leur sens aux constats et aux analyses qui suivent, de fournir quelques précisions sur mon parcours. La réponse à la question soixante-huitarde «D’où c’est-y qu’il parle?» ne permet pas tant de légitimer un propos que d’éviter tout malentendu sur «l’autorité» de celui qui le tient – celle qu’il se donne en prenant la parole tout comme celle qu’on lui accorde. Philosophe et historien des sciences, la préparation de ma thèse sur les liens entre la science et la politique m’a conduit à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), où j’ai fondé en 1963 et dirigé pendant vingt ans la Division des politiques de la science et de la technologie.
Le domaine était nouveau en Europe, l’idée que les ressources scientifiques et techniques – chercheurs, laboratoires, universités – jouaient un rôle essentiel dans les modalités et les taux de croissance économique commençait à peine à faire son chemin dans les milieux politiques et administratifs. À cet observatoire privilégié, j’ai pris la mesure à la fois de l’importance des décisions relatives aux efforts nationaux de recherche-développement et des répercussions, à la fois positives et négatives, qu’entraînent les bouleversements résultant des découvertes et de leurs applications.
Outre les très nombreux rapports publiés sur l’économie de la recherche et de l’innovation, mon équipe a très tôt abordé, avec l’appui du Comité de la politique de la science et de la technologie composé des hauts fonctionnaires chargés de ce domaine dans les pays membres de l’OCDE, les problèmes posés par la gestion du changement technique et, plus particulièrement, l’enjeu de la participation du public aux décisions portant sur ces questions – enjeu démocratique s’il en est. Sous les auspices de ce comité, les dimensions sociales des développements scientifiques et techniques ont commencé à être prises en compte dans les administrations européennes, les préoccupations relatives à l’énergie et à l’épuisement des ressources fossiles ont émergé avant la crise de 1973, et surtout les premiers travaux sur les problèmes de l’environnement ont vu le jour dans une enceinte internationale.
La création de la chaire Technologie et société au Conservatoire national des arts et métiers, dont je suis devenu titulaire en 1978, m’a conduit à donner un enseignement et à animer un doctorat qui était assurément le premier de ce genre en France. À la lumière de l’essor des nouvelles technologies (nucléaire, espace, informatique, biotechnologies, etc.), on y étudiait les liens d’influence réciproque entre le développement scientifique et technique et le développement économique, social et politique – un champ d’étude et d’action qui ne relève pas moins d’une mise en perspective historique que d’une prospective, et qui associe inévitablement plusieurs disciplines : épistémologie, histoire des sciences et des techniques, gestion de la recherche-développement, sociologie de la recherche, économie de l’innovation et des transferts de technologies, écologie et gestion de l’environnement, évaluation et prospective technologiques, stratégies industrielles, aides à la décision. Parmi les jeunes gens qui sont passés par le Centre science, technologie et société du CNAM, nombreux sont ceux qui, en France et à l’étranger – Allemagne, Argentine, Brésil, Corée du Sud, Maroc, entre autres – sont devenus professeurs, chercheurs ou gestionnaires des activités de recherche en ayant conscience des différentes dimensions et répercussions dont celles-ci peuvent témoigner.
J’imagine que c’est cette expérience au cœur des organes de décisions européens, américain et japonais, l’enseignement que j’ai donné, les livres que j’ai publiés, en particulier sur les enjeux politico-économiques de la recherche et les nouveaux risques résultant des progrès scientifiques et techniques, qui ont fait que j’ai été nommé membre du Collège de la prévention des risques technologiques (CPRT), créé en 1989 par Michel Rocard, et que j’ai présidé de 1991 à 1995. Plutôt que d’être rattaché à un ministère ou à un secrétariat d’État dont les compétences pouvaient entrer en conflit d’intérêts avec d’autres départements ministériels, le CPRT avait d’emblée, en étant rattaché aux services du Premier ministre, une fonction couvrant tous les ministères concernés par les problèmes de risques industriels et technologiques: une institution absolument indépendante, de vocation et de mandat interministériels, chargée à la fois de favoriser l’accès plus grand de la société civile à l’information et d’alerter les instances ministérielles sur les mesures à prendre pour réduire ces risques.
Aux termes du décret du président de la République la constituant (n° 89-85 du 8 février 1989), l’institution était d’autant plus originale qu’elle était appelée à « concourir par ses avis, recommandations, ou études, à l’évaluation des risques collectifs et des actions de prévention correspondantes dans les activités industrielles, notamment nucléaires, chimiques et pétrolières, les transports et la mise au point et le développement de technologies nouvelles» (les activités liées à la défense étant exclues). Appelé à répondre aux demandes éventuelles du gouvernement, le Collège disposait par l’article 2 d’un droit de saisine («il peut, de sa propre initiative, examiner toute question relative à sa compétence ») et surtout, innovation absolument originale, il était très explicitement invité à rendre publics ses avis («le Collège envoie au Premier ministre ses avis et recommandations et décide, le cas échéant, de leur publication et des modalités de cette publication »).
Innovation exorbitante, assurément, aux yeux de la technostructure, des habitudes politiques, des lobbies de toutes sortes et du «pré carré» des conseillers: on ne s’étonnera pas qu’elle n’ait pas duré. J’ai présidé le Collège sous deux majorités différentes, rendant compte successivement – la cohabitation aidant – des travaux du CPRT aux conseillers de quatre Premiers ministres, deux socialistes et deux libéraux (13). J’ai raconté ailleurs les remous qu’ont suscités nos avis, certains plus sensibles que d’autres, par exemple ceux qui portaient sur la gestion des déchets nucléaires, sur les problèmes posés par Superphénix, ou sur les transports et l’insécurité routière, tous pourtant marqués au coin du bon sens et d’un souci de vigilance qui passaient comme par définition pour peu orthodoxes (14).
La leçon à tirer des avatars du CPRT est aussi simple que triste: cette institution, précisément conçue par ses initiateurs comme une concession à la société civile pour favoriser l’ouverture et la crédibilité de nos entreprises techniques, est d’entrée de jeu apparue comme un foyer de contestation : totale indépendance de ses douze membres, droit de saisine et surtout publicité des avis, de telles prérogatives au sein de la machine du pouvoir la condamnaient à une mort annoncée. Si gouverner c’est prévoir, suivant la formule définitive de Pierre Mendès France, l’expérience que j’ai eue des allées du pouvoir m’a tout au contraire donné l’impression que l’urgence et l’obsession du «présentisme» telles qu’elles sont conditionnées par les médias, les sondages et les échéances électorales sont en fait l’horizon prioritaire des décisions politiques.
Il en va, hélas, de même sur le plan international, les sources de discordes et de violences étant encore exacerbées par les revendications de souveraineté des États nations. Ce n’est pas par hasard si j’ai choisi ici comme une étude de cas la «leçon des ténèbres» qu’inspire le drame israélo-palestinien, mais du coup face à un conflit à ce point porteur de passions, il est essentiel de préciser combien et pourquoi on se défend d’y céder. Français juif, profondément laïc, j’ai toujours eu à l’égard de l’État d’Israël la sympathie et la distance que lui manifestait mon maître Raymond Aron. «Les Israéliens, disait-il, citoyens d’un pays démocratique, critiquent leur gouvernement. Pourquoi les juifs de la diaspora devraient-ils se sentir tenus de soutenir en toutes circonstances les dirigeants d’Israël? […] Ma tâche est de voir clair et, par chance, je n’ai jamais vu d’incompatibilité radicale entre la justice (ou ce qui passe pour tel ou en approche dans les affaires politiques), les intérêts de la France et ceux d’Israël. Mais, bien entendu, il n’y a rien qui garantisse cette compatibilité (15).» Faut-il préciser ni dans un sens ni dans l’autre?
Je suis allé à plusieurs reprises en Israël, six fois au total, toujours à l’invitation soit du gouvernement soit de l’Académie des sciences, comme consultant en raison de mes fonctions à l’OCDE ou comme conférencier en raison de mon enseignement au Conservatoire national des arts et métiers, de mes recherches et de mes publications. J’y ai quelques vrais et vieux amis dans le milieu universitaire, bien sûr des travaillistes en majorité, parmi lesquels plusieurs ont été proches de Ben Gourion depuis 1948, tous sachant fort bien (et m’en ont toujours été reconnaissants) que mon rapport à l’État d’Israël, fait d’une grande admiration pour ses institutions et ses réalisations sur le plan agricole, industriel, scientifique et technologique, n’a jamais montré la moindre complaisance à l’égard de certains aspects ou tendances de ses orientations politiques et stratégiques.
Avec un groupe animé par l’ambassadeur de France Stéphane Hessel, je suis allé une fois à Gaza et en Cisjordanie occupés – à l’invitation des associations israéliennes qui militent en faveur de la paix, Gush Shalom, B’Tselem, Adalah, le Forum des familles israélo-palestiniennes endeuillées. Ce court périple a suffi pour me faire percevoir ce qu’ont d’intolérables les conditions de vie imposées aux Palestiniens et, pire encore, l’enfermement depuis tant d’années de plusieurs de leurs générations vouées à l’absence d’espoir et donc à la révolte. Les comptes rendus que nous avons publiés à notre retour ont suscité, on s’en doute, des réactions fanatiques de la part de certains représentants de la communauté juive, la moindre réserve à l’égard de la politique de l’État d’Israël passant à leurs yeux pour une manifestation d’antisémitisme (16). Et affirmer que, des deux côtés, la terreur est le résultat du refus d’affronter la paix ne m’a pas fait que des amis.
Mais comment ignorer les témoignages que nous avons entendus, pas seulement ceux des Palestiniens condamnés à l’humiliation d’une vie de reclus sur leurs propres terres, exposés aux incursions, aux brimades, aux bombardements de Tsahal, mais aussi ceux des Israéliens qui n’ont pas renoncé, malgré les attentats, à voir dans les Palestiniens des partenaires? Nul ne peut avoir entendu le témoignage de Nurit Peled-Elhanan plaider pour la paix sans trembler d’émotion: son père, général célèbre de Tsahal, héros des trois «grandes» guerres qu’Israël a subies, était professeur de littérature arabe, spécialiste de Najoub Mahfouz, et s’est très tôt voué au rapprochement entre Israéliens et Palestiniens; après avoir perdu sa fille, âgée de 14 ans, victime d’un attentat à la bombe humaine, elle a créé le Forum des parents endeuillés, où se retrouvent des centaines de familles palestiniennes et israéliennes dont les enfants ont fait les frais du conflit, et elle parcourt les écoles pour parler de respect de l’autre et de réconciliation. À l’entendre, je me suis souvenu d’Albert Camus proclamant, bien avant notre drame algérien, que toute forme de terreur – individuelle ou d’État – pervertit la cause qu’elle prétend défendre. On m’a reproché de ne pas distinguer entre agresseurs et agressés: c’est vrai, je ne crois pas qu’on puisse distinguer entre un enfant israélien tué par un kamikaze palestinien et un enfant palestinien mitraillé par un char israélien.
Au cours de ce périple, j’ai revu mon ami Yaron Esrahi, professeur de science politique à l’Université hébraïque de Jérusalem, qui fut un de mes étudiants quand j’enseignais au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ses critiques à l’égard de l’orientation que connaît son pays depuis plus d’un quart de siècle sont tellement plus sévères et mieux averties! Il ne cesse pas de s’interroger sur le caractère démocratique de la société israélienne : est-elle devenue une ethnocratie mitigée de théocratie, avec une culture guerrière qui explique sa militarisation croissante? De même faut-il se demander où mènent les attentats des kamikazes fondamentalistes musulmans : quel avenir politique peut-on fonder sur cette folie sacrificielle ? Il n’est pas oiseux d’affronter chacune de ces questions avec le même souci de lucidité et d’équité: de la réponse qu’on leur donne, sans céder à l’aveuglement des passions nationalistes et/ou religieuses, dépendent assurément la paix et la sécurité non seulement dans cette région, mais aussi dans le monde. Et il n’est pas possible de les occulter si l’on entend prendre la mesure de tous les risques auxquels la civilisation est aujourd’hui confrontée.
Key words
environment, technical innovation, research, industrial hazard, science and technology
Notes
L’ouvrage « Une civilisation à hauts risques »
Jean-Jacques SALOMON. Une civilisation à hauts risques. Paris : ECLM (Editions Charles Léopold Mayer), 2006. 240 p. ISBN 978-2-84377-130-9. 22€
Téléchargement du livre sur le site des ECLM
Biographie de l’auteur
Jean-Jacques Salomon, professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers, a dirigé la Division des politiques de la science de l’OCDE et présidé le Collège de la prévention des risques technologiques. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les liens entre la science et la société.