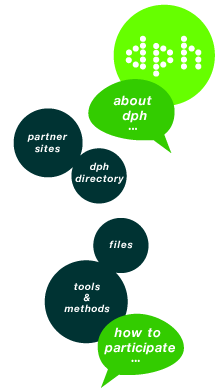On peut raconter l’histoire (vraie) de la découverte du génome comme un gag : il y a 10 ans les généticiens annonçaient 120000 gènes dans le génome humain et ajoutaient avec satisfaction « on en connaît déjà plus des deux tiers ! ». En 2000, ils corrigeaient l’évaluation, la ramenant à 30000, et estimaient alors en connaître 90 %… En 2003 la carte complète du génome est dite « achevée » avec 20000 à 25000 gènes. Cherchez les erreurs ! La surévaluation du nombre des gènes démontre, pour le moins, qu’on est incapable de les définir par leur structure ; quant au triomphalisme affiché sur la proportion des gènes déjà connus, il prouve que le bluff est partie intégrante du « miracle génétique ».
La génétique formelle avait eu recours à une invention utile, il y a un siècle : la notion du gène qui permettait d’imaginer un support matériel, quoiqu’invisible, aux caractères hérités. La génétique moléculaire a ensuite parcouru l’anatomie du génome en quête de ces structures, investies comme constituant la pierre philosophale du vivant.
L’imagerie généticienne a longtemps été puissamment réductionniste. Les étudiants apprenaient à l‘université que chaque gène code pour une et une seule protéine, laquelle détermine un unique caractère. Et réciproquement : tout caractère résulte de l’effet d’une protéine, laquelle est le message délivré par un gène. Pourtant, en même temps que l’on assistait aux extraordinaires avancées techniques dans la dissection du génome et aux premières approches de mécanismes explicatifs de pathologies génétiques, se faisait jour une complexité imprévue.
Par exemple : l’ADN apparaît finalement surtout composé de parties apparemment non codantes (« introns », un peu vite taxés d’ « ADN poubelle ») ; par ailleurs, de nombreux « exons » (parties codantes), plutôt qu’un seul, peuvent être impliqués dans la fabrication d’une seule protéine et/ou dans la manifestation d’un caractère.
Mais ce sont surtout des faits surprenants (surprenant du moins l’orthodoxie théorique des généticiens…) qui soulevèrent de sérieux questionnements. C’est en clinique médicale que sont apparus ces faits, relativisant le rôle des gènes : certains d’entre eux, considérés jusqu’alors comme déterminant certaines pathologies, se sont révélés absents chez certains malades et présents chez des personnes saines.
Il fut également démontré que certains syndromes pathologiques considérés comme génétiquement transmissibles, pouvaient sauter des générations, ou que des gènes eux-mêmes pouvaient sauter d’un locus (lieu occupé sur un chromosome) à un autre. L’évidence d’une gradation individuelle dans la gravité des atteintes par une maladie génétique fut également source de remise en question. Comment, enfin, expliquer qu’une protéine pathologique, le prion de la « vache folle », soit issue d’un gène normal, d’une part, et capable d’induire la pathologie de protéines saines, d’autre part ?
S’ajoutant à ce premier cortège de démentis de la théorie du « tout génétique », des manipulations réalisées sur le vivant sont venues récemment aggraver le trouble des zélateurs du génome. Alors que la thérapie génique ne parvient toujours pas à assumer son ambition de guérir les maladies monogéniques, la transgénèse animale amène à s’interroger. On a, par exemple, voulu ajouter au génome un gène codant pour l’hormone de croissance afin d’augmenter le rendement du vivant (viande, lait…). La souris de laboratoire, ainsi modifiée pour la première fois, s’était montrée stérile et sujette à diverses fragilités. La même manipulation réalisée récemment chez des animaux d’élevage a conduit à des moutons ou vaches diabétiques et à des saumons difformes, sans qu’on puisse expliquer le rapport entre la modification introduite dans le génome et l’effet négatif obtenu.
Plus accablant : par recours au « clonage thérapeutique » chez la souris, on a pu obtenir des cellules souches à partir d’embryons possédant le même génome que la souris malade (après transfert d’un de ses noyaux cellulaires dans un ovule énucléé). Pourtant ces cellules ont été rejetées après leur greffe chez cette même souris alors qu’elles étaient supposées éminemment compatibles…
Citons enfin la principale leçon du « clonage reproductif » : quand un noyau cellulaire, naturellement bridé pour assurer les seules fonctions du tissu où on l’a prélevé, est introduit dans un ovule énucléé, il se montre totipotent, c’est-à-dire capable de contribuer à toutes les fonctions nécessaires à la vie d’un nouvel individu, révélant que son activité dépend largement de son environnement. Ainsi c’est la partie non génomique de l’ovule qui se comporte en chef d’orchestre, une fonction jusqu’ici attribuée au génome.
Quelques brèves conclusions qui devraient être tirées de ces observations : le génome n’est pas un Meccano dont les pièces seraient aisément interchangeables, il n’est pas la seule source d’informations dans l’organisme vivant, il n’est pas un « programme du vivant » mais seulement une base de données parmi d’autres.
C’est dire que le génome est à la fois plus complexe et moins directif qu’on l’avait cru. Cette conclusion est aujourd’hui partagée par la plupart des biologistes moléculaires, mais ils rebondissent en lançant de nouveaux enjeux, et toujours sans analyser leurs responsabilités dans l’utopie scientifique et technologique du dernier demi-siècle. Certes, il est raisonnable de s’intéresser aujourd’hui à la fonctionnalité du génome (« protéomique ») ou à sa dépendance vis-à-vis de l’environnement (facteurs épigénétiques) mais ces pistes risquent d’ouvrir de nouveaux programmes géants sans qu’un bilan critique du passé soit disponible, c’est-à-dire sans qu’on ait tiré des leçons permettant de limiter les erreurs à venir.
Pendant trente ans « on » (les chercheurs, les industriels, les politiques et médias qu’ils manipulent) a fait croire que le génome constituait le « programme » du vivant, on a vendu l’idée du « gène-médicament » et celle d’une nature (bêtes et plantes transgéniques) complètement maîtrisée au service de l’homme. Des opérations rituelles avec sacrifices (« courir contre la maladie ») et professions de foi à répétition (« on est presque au but ») ont culminé avec le Téléthon, attisant la pitié publique au point de recueillir en 36 heures des dons d’un montant équivalent au budget de fonctionnement annuel de toute la recherche médicale française. Devant l’échec de la stratégie de thérapie génique, le lobby scientifique et industriel se précipite vers une stratégie de traitement grâce aux cellules-souches, entretenant la confusion entre gènes et cellules comme pour éviter de présenter un bilan. Certains diront que ces recherches-là ne sont pas critiquables quels qu’en soient les résultats. C’est oublier que les laboratoires de biologie, de plus en plus privés de dotations publiques récurrentes, sont facilement enrôlés sous cette bannière biotechnologique grâce à une manne providentielle, sacrifiant ainsi d’autres voies de recherche dont l’intérêt public pourrait être supérieur. Surtout, il est navrant que la science serve de caution à ces opérations alors qu’il y a détournement de l’outil public de recherche (personnels, locaux, matériels…) vers des besoins certes authentiques mais minoritaires : un groupe de pression impose sa propre priorité, qui échappe aux procédures usuelles et à un véritable contrôle par l’institution. La rigueur scientifique est aussi mise à mal par une mystification organisée du public (et des malades) selon des pratiques qui empruntent plutôt au marketing.
L’important dispositif médiatique qui encadre la génomique ne cesse de proclamer ses prétentions hégémoniques : la nouvelle médecine sera celle qui enquête sur le génome pour établir son diagnostic, et utilise les « gènes-médicaments » pour guérir. Cela doit être indiscutable (J. Testart : Le désir du gène, Flammarion, coll. Champs, 1994). Dès lors, tout investissement de recherche hors du génome ne pourrait être que palliatif, en attente de la bonne solution, voire un gaspillage. L’avenir dira ce que cette attitude comporte d’illusions mais l’actualité permet de constater sa volonté globalisante, voire totalitaire. L’exemple des plantes transgéniques est riche d’enseignement à cet égard.
Plantes transgéniques : l’hégémonie de l’absurde
On peut s’interroger sur les raisons qui ont fait regrouper sous l’intitulé commun « OGM » (pour Organismes Génétiquement Modifiés) des chimères transgéniques aussi différentes que des cellules individualisées ou des microorganismes d’une part, et des plantes ou animaux entiers d’autre part. S’il est bien montré que les cellules isolées peuvent être génétiquement modifiées de façon assez bien maîtrisée, les exemples donnés plus haut pour les animaux recevant un gène d’hormone de croissance indiquent les limites de la maîtrise pour les organismes plus complexes. De plus, les microorganismes transgéniques sont cultivés en fermenteurs, selon de strictes obligations de sécurité alors que les animaux (ex: poissons), et surtout les plantes, occupent l’espace public. Il est alors tentant pour les défenseurs de la transgénèse animale ou végétale de se référer aux cultures cellulaires pour illustrer les bienfaits des « OGM » (« déjà plus de la moitié des vaccins sont produits par des OGM ») et en démontrer la maîtrise (l’effet obtenu est bien l’effet recherché et il est permanent; les règles de sécurité empêchent toute contamination…). Alors que la commercialisation d’animaux transgéniques commence à peine, celle des plantes (qu’il est sage de nommer PGM = plantes génétiquement modifiées) a envahi l’agriculture depuis 1996 et couvre aujourd’hui 70 millions d’hectares, ce qui autorise un bilan d’étape.
Notons d’abord que les PGM le plus souvent citées dans la propagande n’ont pas d’existence réelle : la tomate à longue conservation, première production transgénique commercialisée (1994), a été vite abandonnée, son goût rebutant même les consommateurs des USA (mais les conditions douteuses de son homologation, malgré l’avis des experts scientifiques, expliquent aussi ce prudent retrait) ; le riz produisant la provitamine A est en échec, aucune personne ne pouvant absorber les 9 kg quotidiens nécessaires pour obtenir la dose requise de vitamine ; les plantes capables de pousser en terrains très riches en sel ou désertiques en sont toujours au stade de la recherche. Quant aux « plantes-médicaments » supposées capables de fournir l’industrie pharmaceutique en substances variées, elles n’ont jamais produit ces molécules en quantités suffisantes pour arriver au stade de commercialisation (contrairement aux OGM de laboratoire).
Qu’en est-il des PGM réellement cultivées (sur le continent américain et en Chine essentiellement) ? Il s’agit à 98 % de plantes capables soit de produire elles-mêmes un insecticide, soit de tolérer les épandages d’herbicides. Dans les deux cas, l’effet bénéfique initial s’atténue en quelques années parce que les pestes ainsi combattues se sont adaptées : insectes parasites mutants capables de résister à l’insecticide ; plantes adventices résistantes parce qu’auto sélectionnées ou devenues elles-mêmes porteuses du transgène. Or, la variété des constructions génétiques susceptibles de transformer les végétaux cultivés dans le sens recherché n’est pas très grande et le risque existe (comme avec les antibiotiques) de se trouver démuni devant une nouvelle configuration parasitaire. De plus, ces PGM ont des effets indésirables sur l’environnement. Dans le cas des plantes productrices d’herbicides, ces substances toxiques sont produites en continu, et par toutes les parties de la plante, ce qui, par rapport aux traitements conventionnels augmente considérablement, leur distribution à l’hectare (10000 fois selon certaines estimations), et donc leurs effets dévastateurs sur l’environnement, particulièrement les insectes ou les oiseaux. Dans le cas des plantes tolérantes à un herbicide, celui-ci est alors appliqué massivement (souvent en quantités doubles ou davantage) avec des conséquences stérilisantes pour la biologie du sol (micro-organismes, vers, etc.).
Il est frappant de constater la volonté d’une action radicale exercée sur les pestes : éradiquer les mauvais herbes et les insectes parasites, telle est la mission de ces PGM. Elle diffère sensiblement de l’attitude traditionnelle du paysan, résolu à préserver sa récolte mais par un « pacte armé » avec la nature plutôt que par éradication. Car le paysan sait que l’ensemble vivant auquel il appartient est beaucoup trop complexe, chargé d’interférences, pour s’autoriser des actions radicales au risque de catastrophes imprévues. C’est bien une logique totalitaire qui anime le système PGM, même si les éléments naturels résistent à cette ambition.
L’excès de pesticides présents dans les PGM, soit par génération autonome (insecticides) soit par imprégnation (herbicides) pourrait présenter des risques sanitaires pour les animaux ou les hommes qui les consomment. On peut aussi s’interroger sur l’éventuelle transmission aux bactéries qui peuplent notre tube digestif de propriétés nouvelles induites par les transgènes ingérés. Ces risques n’ont pas été sérieusement étudiés tant il est admis que les plantes transgéniques ne font que poursuivre le projet classique d’amélioration des espèces, lequel a fait ses preuves d’innocuité… C’est confondre la sélection variétale et les croisements traditionnels avec la production de chimères qui mélangent l’animal et le végétal (avait-on déjà mis des gènes de poisson dans les fraises ?).
Afin de contrer les réticences (surtout européennes) à la culture et la consommation de PGM, deux types de mesures ont été proposées, fondées sur une apparence de démocratie. D’abord la « coexistence », c’est-à-dire une réglementation supposée capable de permettre la culture de plantes transgéniques et conventionnelles sur les mêmes territoires, pari qui semble impossible à tenir durablement, du fait des phénomènes naturels de dissémination, qu’il est impossible de contenir. Ensuite l’étiquetage des produits issus de PGM, mais seulement quand ils sont destinés à la consommation humaine directe, afin de permettre le « libre choix » du consommateur. Là, l’utopie technologique rencontre l’utopie démocratique, qui laisse croire que tout citoyen, même sans avoir été correctement informé, pourrait faire un choix éclairé, mieux que les experts qui se contredisent…
Si des agriculteurs se lancent dans les cultures de PGM, c’est qu’ils en escomptent une économie de main d’œuvre, laquelle est bien réelle dans un premier temps : suppression des aspersions d’insecticides, diminution des passages d’herbicides (d’où les doses massives…). C’est aussi que les industriels consentent des avantages initiaux aux « pionniers du progrès » pour mieux les entraîner vers des pratiques difficilement réversibles. Mais l’illusion de miracles promis par la propagande, n’est certainement pas étrangère à cette disponibilité. Bien sûr, les PGM ne sont en aucune façon la solution aux famines, lesquelles relèvent d’une distribution inégale des produits agricoles, et non de leur insuffisante production. Au contraire, les « pays en développement » qui recourront aux PGM se priveront encore davantage de leurs ressources vivrières et aggraveront leur dépendance par rapport aux pays riches à qui ils achèteront des semences et fourniront de la nourriture. De façon générale, le progrès agronomique n’a aucun besoin des PGM. Il passe par la poursuite de la sélection des variétés les mieux adaptées à chaque terroir, et non l’adaptation de tous les terroirs à une variété unique, par la rotation des cultures, les associations variétales dans le même champ, le non-retournement des sols, (lire
Impact des OGM sur les agrosystèmes. D’autres systèmes agraires sont possibles. In: société civile contre OGM. Collectif cc-ogm, Ed. Yves Michel,
2004.) Au total, les PGM relèvent d’un énorme bluff technologique auquel participent les institutions, et, au premier rang, de nombreux chercheurs, malgré un fiasco déjà évident. C’est qu’un vaste marché est en jeu, celui des semences GM brevetées que les agriculteurs devront acheter cher, et renouveler chaque année puisqu’il est interdit de les ressemer… Pour les multinationales, qui ont ajouté à leur domaine d’origine (la chimie) celui des variétés végétales (par rachat des semenciers), il s’agit de créer un marché captif, faisant dépendre de leurs intérêts propres tous les aspects de l’alimentation mondiale (variétés utilisées, traitements phytosanitaires, travaux agricoles, commercialisation…).
Les défenseurs des PGM fuient de plus en plus les débats contradictoires. Ayant éprouvé la faiblesse de leur argumentation ils préfèrent les soliloques dans la presse bienveillante. De plus, ils reprochent à leurs opposants d‘être presque tous « anti-nucléaires » en même temps qu’ « anti-OGM », ce qui démontrerait leur passéisme généralisé. Comme si le souhait d’une humanité épanouie dans une société démocratique et un environnement sain était une conception passéiste ! Mais il y a bien une attitude commune aux pro-nucléaires et aux pro-PGM : ils refusent de reconnaître les faits et les problèmes réels, au risque de créer des problèmes nouveaux et irréversibles, en se persuadant qu’une solution encore inconnue va miraculeusement survenir. Cela explique que les confrontations débouchent stérilement sur l’accusation de « pessimisme » ou « catastrophisme » proférée contre ceux qui ne veulent pas compter sur des miracles pour sauver la planète et ses habitants.
Key words
genetics, genetic improvement, Genetically modified organism (GMO), technological innovation
file
Ideas, Experiences and Proposals On Sciences and Democracy
Notes
Jacques Testart est directeur de recherche à l’INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale (www.inserm.fr)