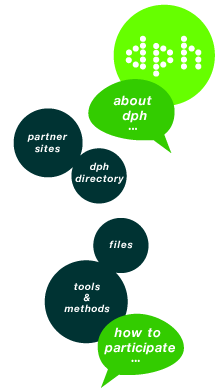La question du changement climatique induit par les émissions de CO2 résultant de la combustion effrénée des combustibles fossiles aurait-elle une solution géologique ? En d’autres termes, les géologues sont-ils capables de prendre leur part de responsabilité pour tirer l’humanité de ce pétrin dont elle a bien profité à court terme ?
Les géologues savent bien que, avant les périodes d’accumulation de biomasse qui ont permis de séquestrer une quantité considérable de carbone dans la croûte terrestre, notre planète baignait dans une atmosphère torride. Ils savent aussi que les ressources fossiles sont stockées en quantité limitée, notamment pour ce qui concerne le gaz et le pétrole. On ne sait pas si la courbe de demi-vie établie en son temps par K. Hubbert (1956) sera atteinte en 2010 ou en 2030, mais il est sûr qu’un certain nombre d’entre nous pourront le vérifier. On sait que le charbon est plus abondant, et servira quelques centaines d’années encore. Mais on sait aussi qu’il est encore plus émissif en CO2 que le pétrole…
Les géologues ont-ils des solutions à proposer ou du moins des contributions à apporter pour l’avenir ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre.
La séquestration géologique du CO2
Après tout, contemplant maintenant le verre à moitié plein, on peut se rassurer en se disant que nous n’avons consommé que la moitié des ressources d’hydrocarbures. Et il nous reste encore de très grandes quantités de charbon.
La tentation est grande, et l’humanité n’y résistera sans doute pas, de taper sans vergogne dans ces stocks-là au cours des prochaines décennies.
Mais pour que la planète le tolère, et qu’en fin de compte, la facture à payer ne soit pas supérieure à l’économie qu’on croit faire, en différant encore le recours aux renouvelables, il faut régler le problème des émissions de gaz à effet de serre. Trouver le moyen de continuer à brûler - avec une modération nouvelle qui découlera naturellement de cette obligation - sans émettre de CO2.
D’autant que, si l’on parle de la « société de l’hydrogène », on n’est pas près de faire de l’hydrogène par hydrolyse de l’eau, même avec un nucléaire à bas prix ! Pendant des dizaines d’années encore, il sera beaucoup moins cher de produire l’hydrogène à partir des carburants hydrogénés. Et quand il n’y aura plus ni méthane ni pétrole, il sera toujours plus économique d’utiliser le charbon comme source d’hydrogène plutôt que de l’eau. Bien entendu, cette solution ne pourra être mise en œuvre sans régler le problème des émissions de CO2.
En fin de compte, dans les filières hydrocarbures, charbon et hydrogène de demain, la séquestration géologique du CO2 fera partie des solutions possibles. La question est : où, comment et à quel prix ?
C’est faisable géologiquement
Stocker du gaz en formation géologique n’est pas une approche nouvelle. Elle est largement répandue, et exploitée sur plusieurs sites en France. Concernant le CO2, si l’on doit se contenter actuellement de deux sites expérimentaux sous le plancher de la Mer du Nord et à terre au Canada, on sait que la géologie a naturellement produit des réservoirs de CO2, que les recherches d’hydrocarbures ont notamment permis de découvrir (à défaut de pétrole ou de gaz). Plusieurs gisements de gaz sont faits de méthane, de CO2 et d’autres gaz. C’est notamment le cas du gisement de mer du Nord qui fait l’objet du programme européen.
On connaît dans le Sud-Est de la France une vaste région géologique carbo-gazeuse, où des réservoirs scellés depuis des millions d’années voisinent avec des sources dont plusieurs sont exploitées.
C’est maîtrisable technologiquement
Ce sont les services géologiques européens qui ont lancé l’idée en 1993-1995 dans le cadre du Programme JOULE II avec un projet intitulé « The underground disposal of carbon dioxide ». Les principaux résultats ont été la validation du concept, l’existence de gisements naturels de CO2, l’identification d’un potentiel important de stockage (800 Gt, comparé à des émissions industrielles européennes de 1 Gt/an), et le fait que beaucoup de maillons technologiques nécessaires à une filière de stockage ont déjà fait leurs preuves.
Une forte relance des programmes de recherche européens a suivi Kyoto. Bien entendu, le développement de ces technologies sera lié au développement des échanges de permis d’émissions. Au plan européen, une étape a été franchie avec la Directive européenne établissant un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) puisque la capture et le stockage du CO2 pourront être déduits du niveau calculé des émissions des installations industrielles couvertes par la directive.
Depuis, les projets se sont succédé et on est parvenu à développer une première expérimentation européenne en grandeur réelle en Mer du Nord à SLEIPNER. Les équipes européennes se sont aussi associées au projet Nord-américain de stockage de CO2 émis par une centrale à charbon combiné à la récupération assistée de pétrole dans le champ de WEYBURN au Canada.
Les recherches se poursuivent en Europe, aux USA, au Canada, en Australie et au Japon pour préciser toute une série de points : processus physiques et chimiques dans les réservoirs, sélection des sites de stockage, impact du CO2 sur le réservoir, évaluation des risques, réduction des coûts, etc..
Un enjeu important porte sur les aquifères salins terrestres, qui représentent le plus fort potentiel, notamment si l’on considère la géographie des sites de production fixes susceptibles de produire des quantités suffisantes de CO2 pour justifier d’installations de stockage. C’est aussi sur cet enjeu que se concentrent le plus de questions de sécurité à long terme.
C’est accessible économiquement
Au plan économique, les données disponibles permettent de mieux cadrer les différents coûts de capture, de transport et de séquestration géologique. Les coûts de capture représentent de 70 à 90 % des coûts totaux, soit 5 à 40 US$/tonne de CO2 capturé. Ceux de transport sont fonction de la distance, du diamètre des pipes et donc du volume des émissions. Ils varient de 1 à 3 US $/t CO2 et par 100 km. Lors de simulation sur des configurations réelles, les coûts de stockage varient de 1 à 2 US $/t CO2 injecté dans le sous-sol. Selon l’IEA, l’ordre de grandeur du coût global Capture + Transport + Stockage (océan ou sous-sol) est de 40 – 60 US $/t CO2 évitée.
Dans ce bilan, la part la plus élevée revient à la capture qui représente le champ de progrès le plus grand. On peut en effet jouer sur les technologies en bout de chaîne (à l’aval des turbines), comme on peut promouvoir des approches intégrées (oxy-combustion). Au total, les coûts de séquestration ne sont pas hors d’atteinte, et n’entraîneraient guère plus qu’un doublement des prix des énergies fossiles, ce qui peut paraître intolérable aujourd’hui, mais correspond mieux à la réalité à venir à laquelle on a tout intérêt à se préparer dès aujourd’hui.
Pour des coûts de stockage inférieurs à 20 US $/t CO2, les potentiels des réservoirs d’hydrocarbures (pétrole ou gaz) épuisés sont de 950 Gt CO2 soit 45 % des émissions jusqu’en 2050, ceux des charbons inaccessibles ou inexploitables, 40 Gt CO2 soit 2 % des émissions jusqu’en 2050, ceux des aquifères salins profonds, 400-10000 Gt CO2 soit 20 à 500 % des émissions jusqu’en 2050.
Toutes ces données montrent que le développement de la filière reposera sur la proximité des sites de stockage vis-à-vis des centres d’émission (centrales thermiques…). Des distances de plus de 1000 kilomètres deviendront rédhibitoires… Elles montrent aussi que les aquifères salins constituent l’enjeu majeur des R&D à venir.
C’est limité
Comme on le voit, si les ressources géologiques disponibles en matière de sites de séquestration sont importantes, il reste que leur répartition est aussi inégalitaire que celle des ressources. On ne peut pas rêver de stocker en profondeur du CO2 n’importe où. Comme pour les ressources fossiles, on devra développer la connaissance des gisements, dont la qualité physique, en terme de sécurité à long terme, deviendra un atout économique. On dispose de peu de scénarios chiffrés sur les quantités de CO2 réellement stockables d’ici 2050 ou 2100. Mais une étude du Club d’ingénierie prospective (CLIP), à paraître, montre que l’industrialisation massive de cette technologie à partir de 2020 permettrait théoriquement d’éviter au maximum 45 % des émissions cumulées entre 2000 et 2050 (460 Gt de carbone), à condition d’atteindre l’objectif de division par deux des consommations énergétiques du procédé de capture en post-combustion (adapté aux centrales existantes) et celui de l’installation systématique à partir de 2020 de centrales à oxy-combustion pour le renouvellement et l’extension du parc.
Mais si l’on tient compte de la géographie, le bilan est nettement moins favorable. En effet, les régions bien dotées pour le stockage en gisements d’hydrocarbures ne représentent qu’une faible part du potentiel mondial de capture. La Russie ou le Moyen-Orient représentent à eux seuls 60 % des capacités de stockage alors que la capture de leurs émissions n’en représente que 10 %. Et la prise en compte d’un seuil de 1000 km entre source et site de stockage réduit de façon sensible le potentiel de la filière ; c’est ainsi que les pays couvrant 80 % du potentiel de capture ne pourraient éviter plus de 16 % de leurs émissions cumulées d’origine électrique de 2000 à 2050, de l’ordre de 6 à 7 % de leurs émissions totales de CO2 dues à l’énergie.
Qu’en conclure ?
Une économie de la séquestration géologique est en passe de voir le jour, avec des opérateurs et des agents de contrôle de sécurité externes, mais limitée aux espaces dotés de caractéristiques géologiques adaptées. Elle repose sur l’hypothèse d’un doublement du prix des énergies fossiles.
Les incertitudes sur les enjeux à l’horizon 2050 reposent largement sur les capacités de stockage en veines de charbon et en aquifères profonds salins, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Le déficit actuel de recherche et de pilotes sur ces gisements en fait un enjeu majeur pour la R&D.
Mais, en acceptant l’ardente obligation de doubler le prix des énergies fossiles, et de l’hydrogène dérivé, on participe en même temps à la solution de la question des émissions atmosphériques et à celle de la régulation par les prix, en aidant les renouvelables à passer le cap économique qui bride aujourd’hui leur développement. Ce qui nous amène à parler d’une autre utopie géologique : la géothermie.
La géothermie assistée
(en anglais EGS : enhenced geothermal systems)
Comme le montre le drame asiatique, notre planète est bien vivante et dissipe en permanence une grande quantité d’énergie de l’intérieur vers la surface. En dehors du mouvement des plaques tectoniques, et des séismes qu’elles génèrent, l’énergie est essentiellement dissipée sous forme convective. Le flux de chaleur est en moyenne de 80 watts par km2, et se traduit par une augmentation de température de 3 à 4 °C/100 m avec la profondeur. Les roches sont en conséquence portées à des températures moyennes de l’ordre de 200 °C à 5000 mètres de profondeur. En outre, dans les zones actives (frontières des plaques), la chaleur peut produire des flux bien supérieurs, de l’ordre du MW par km2. On peut atteindre des températures de 250 à 300 °C à une profondeur de 1000 à 1500 mètres, et des fluides supercritiques à des profondeurs de 3000 à 5000 mètres.
La géothermie conventionnelle
Pour exploiter cette immense ressource, il est nécessaire de disposer en outre d’un bon échangeur de chaleur, et d’un dispositif permettant d’assurer le transfert de l’énergie depuis les profondeurs vers la surface. L’échangeur peut être, soit naturel, soit construit par fracturation hydraulique à partir de la surface.
Quoique relativement abondants, les gisements naturels sont encore peu utilisés. On compte en effet 8 GWe installés et une production annuelle de 49 TWh. Cela tient :
-
Soit à leur coût. C’est le cas des aquifères profonds du bassin de Paris, dont le développement est handicapé par le manque de réseaux de chaleur. Ils ont été rentables entre 1975 et 1985, lorsque le prix du pétrole était élevé, mais aucune opération nouvelle n’a vu le jour depuis la baisse des prix du pétrole.
-
Soit à leur localisation dans des gisements à découvrir, situés dans des zones géographiques particulières (massifs volcaniques, îles océaniques, zones tectoniques actives…), souvent éloignées des centres de consommation.
Néanmoins, on est très loin d’un usage optimal de ces ressources, pourtant accessibles économiquement avec les technologies disponibles aujourd’hui, et particulièrement abondantes dans les pays du Sud peu industrialisés (Indonésie, Philippines, Amérique latine, Afrique de l’Est…). Les investissements sont en effet de 1250 à 2500 $/KWe, soit une production de 3 à 10 cents de $ par KWh électrique. Leur mise en valeur devrait bénéficier des mécanismes de Kyoto (MDP notamment), et de ceux qui suivront dans le cadre des négociations climat. On prévoit plus qu’un doublement à l’échéance 2010, les capacités installées passant de 8 à 19 GWe.
La géothermie assistée
Beaucoup d’espoirs se fondent aujourd’hui sur les programmes de géothermie assistée. Après l’échec des approches américaines (développées à Los Alamos) visant à créer de toutes pièces des échangeurs profonds par fracturation, on a développé en Europe une approche plus modeste, plus réaliste aussi, visant à bénéficier des fractures préexistantes, même si elles ne sont pas actives. La technologie expérimentée à Soultz-sous-Forêt dans le cadre d’un programme européen vise à stimuler des fractures préexistantes et à établir un échangeur profond entre plusieurs puits. Après des essais fructueux à partir d’un « doublet » à 3500 m de profondeur, les essais sont en cours sur un « triplet » à 5000 mètres. Une unité pilote permettra alors de tester l’économie réelle de cette technologie, dont le coût d’investissement est grandement dépendant de celui des forages. La durée de vie de l’échangeur créé en profondeur, et plus précisément l’enjeu de son extension au cours du temps, constitue un autre facteur clé de la réussite économique de cette filière.
Mais il faut souligner que l’on n’est plus ici dans le concept de « géothermie profonde généralisée » que certains appelaient de leurs vœux. Les technologies EGS ne pourront être développées que sur des sites géologiques spécifiques - des zones fracturées comme on en connaît en Alsace, en Limagne, ou dans le massif Central - et pas partout !
C’est limité
Les évaluations sur les perspectives de la géothermie varient considérablement selon les auteurs. Les Islandais annoncent des chiffres atteignant 2940 GWe, mais les consensus internationaux indiquent plutôt 138 GWe, soit 8,4 % de la consommation électrique mondiale, pour la géothermie conventionnelle. Un doublement pourrait être atteint avec la technologie EGS. Pour l’essentiel, cette production se concentre en Amérique Centrale, en Indonésie, en Afrique de l’Est et aux Philippines.
Au plan géopolitique, on assisterait ainsi à une nouvelle donne, bien différente de l’actuelle, fondée sur une autre rationalité géologique. À l’aire des bassins sédimentaires succéderait celle des zones volcaniques actives. Comme des progrès importants ont été faits en matière d’exploration pétrolière sur les bassins, on peut s’attendre à des progrès équivalents dans ces espaces souterrains aujourd’hui très mal connus. Un pays comme l’Islande, qui dispose à la fois de ressources exceptionnelles, de capacités technologiques et d’une volonté politique affirmée de se libérer des énergies fossiles émettrices, pourrait devenir un exportateur d’hydrogène. En effet, les technologies de vapocraquage à haute température - faciles à atteindre en géothermie - apparaissent déjà comme les plus attractives. Si l’on table sur le commerce de l’hydrogène, une nouvelle géographie des ressources énergétiques se dessine, bien différente de celle du pétrole.
Reste que la géothermie, même si elle permet potentiellement d’importantes productions d’énergie lorsque le gisement naturel l’autorise (soit parce qu’il est suffisant pour assurer la production, soit parce qu’il permet d’effectuer de bonnes stimulations), est loin d’offrir une solution unique et générale en matière d’énergie pour demain.
Les technologies EGS, si elles permettent d’élargir le spectre de la géothermie « naturelle » - en en renchérissant le coût – ne permettent pas non plus de considérer la géothermie profonde comme une nouvelle solution universelle !
Résumons-nous
En matière d’utopie, la plus pernicieuse serait de croire que l’on pourrait sans vergogne, sans changer radicalement nos habitudes quotidiennes personnelles et nos choix de société, continuer à vivre comme avant sous la dépendance des hydrocarbures fossiles. Nous sommes dans l’obligation de trouver des alternatives. Leur caractéristique commune, c’est d’être moins faciles à distribuer, plus dépendantes de sites et de régions spécifiques, et en fin de compte plus chères.
Les options qui sont ouvertes ne sont pas toutes utopiques, pour peu qu’on accepte de ne pas les considérer, à la différence du pétrole, comme la panacée. Comme on le voit, c’est de l’ordre de 6 ou 7 % des émissions de CO2 que l’on pourra éviter par stockage géologique, ou avec la géothermie, en cas de succès de la technologie EGS. Ces chiffres incitent à la modestie. Il faudra apprendre le discernement, développer une nouvelle intelligence. Cette démarche imposera, non pas de se détourner d’une terre épuisée par un siècle de jouissance sans mesure, mais d’en apprendre les subtilités.
Après avoir bénéficié du plus facile, même au prix de ce que nous considérons aujourd’hui comme des prouesses technologiques (offshore profond, récupération assistée…), il nous restera à gérer sur le long terme les déchets de ces années glorieuses. Et, pour le reste, apprendre à discerner les plus subtiles ressources ; commencer à pratiquer, entre l’homme et son substrat minéral, une relation plus digne après des années de mépris, voire de diabolisation.
4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable) - Cité européenne des Récollets, 150 – 154 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris, FRANCE - Tél. : 01 44 64 74 94 - Fax : 01 44 64 72 76 - France - www.association4d.org - contact (@) association4d.org