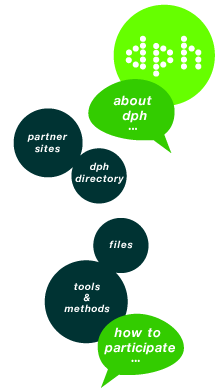Le mythe du marché : le cas américain
L’interventionnisme étatique étasunien
04 / 2006
La vision la plus répandue et néanmoins caricaturale de l’économie étasunienne, serait celle d’un libéralisme dominant pourvoyeur de la libre-entreprise et à l’origine d’un tissu de petites entreprises particulièrement dynamiques tant sur le plan de la production que de l’innovation. Dans une telle perspective, l’Etat resterait discret au possible, réduit à ses fonctions régaliennes de peur de n’entraver l’efficience du marché.
Pour Neil Fligstein cette vision est non seulement simpliste mais qui plus est erronée, l’Etat étasunien étant « depuis l’origine, profondément impliqué dans le fonctionnement de l’économie nationale, et ce d’une façon qui n’est guère étrangère aux européens » .
Dans sa volonté de démystification qui est la sienne, l’auteur s’essaie à l’analyse des deux emblèmes du capitalisme étasunien contemporain : celui de la valeur actionnariale et celui de la silicon valley tous deux considérés à tort comme les émanations d’un capitalisme efficient et innovant car dérégulé.
La valeur actionnariale
Derrière le concept de valeur actionnariale, couve l’idée d’obligation pour l’équipe dirigeante d’assurer un taux de profit maximal aux actionnaires. Le fondement idéologique sous entendu ici n’est pas récent, c’est celui du contrôle des sociétés (corporate control) développé dans les années 1960 et qui vise à déterminer par quels procès les dirigeants et les propriétaires d’une entreprise peuvent faire fructifier leurs capitaux. La question est donc de savoir comment sa version actionnariale a-t-elle pu devenir dominante ? Une mise en perspective historique est sur ce point nécessaire.
Aux Etats-Unis a d’abord prévalu dans les années 1960 à 1970 une conception dite financière du contrôle des sociétés. La firme y était alors vu en quelque sorte comme un « paquet » d’actifs que l’on pouvait déployer pour acquérir des filiales selon leur profitabilité. Ce type de contrôle permettait de stabiliser les résultats des entreprises, de leur créer une sorte de couverture-risque en diversifiant leurs capitaux. Cette stratégie fut possible car les entreprises étasuniennes étaient déjà diversifiées après la seconde guerre mondiale, mais aussi paradoxalement parce que les lois anti-trust étaient strictement appliquées (toute fusion avec un concurrent ou un fournisseur étant interdite, soit toute concentration verticale ou horizontale). De façon incongrue cette situation juridique a renforcé les processus de fusion-acquisition mais dans des secteurs totalement différents, si bien que dans les années 1960 les conglomérats vont se multiplier et le rôle des directeurs financiers prendre des proportions considérables.
Mais rapidement, les Etats-Unis vont rencontrer plusieurs difficultés : celles de l’inflation, du ralentissement économique et d’une sévère concurrence étrangère notamment nippone. Ainsi, à la fin des années 1960, les cotations des entreprises étasuniennes sont inférieures à la totalité de leurs actifs en liquidité. En réponse à cette crise, va donc se mettre progressivement en place un contrôle des sociétés de type « valeur actionnariale » et l’Etat jouera un rôle prépondérant dans ce processus. Si les réformes vont débuter sous Carter, c’est véritablement sous Reagan qu’elles vont s’exécuter. Tout d’abord la loi anti-trust est assouplie dès 1981, autorisant de ce fait la très grande majorité des fusions. Puis, les réformes fiscales se multiplient et les impôts se voient considérablement allégés. Rapidement il devient alors plus rentable de diviser les grandes entités en une multitude de petites, d’autant plus que les innovations financières suivent. Les entreprises vont donc pouvoir mais aussi être obligées de réorganiser leurs actifs en gardant en permanence à l’esprit le traumatisme de la perte de leur hégémonie mondiale et donc implicitement l’idée que si les actifs des entreprises avaient été sous évalués sur le marché boursier, c’est parce que l’équipe dirigeante n’avait pas su en maximiser la valeur boursière. Les directions d’entreprises vont donc désormais avoir pour objectif premier la bonne réputation sur les marchés boursiers, et les achats et rachat d’actions vont se multiplier. Cette « rhétorique de la valeur actionnariale se fondait ainsi sur un manque d’égard envers les employés, les consommateurs ou les fournisseurs au nom de profits plus élevés et immédiats des actionnaires » .
Mais cette nouvelle stratégie véritablement permise sinon enclenchée par l’Etat a-t-elle eu les effets escomptés ? L’auteur affirme que les travaux empiriques sont catégoriques : les réorganisations n’ont ni permis aux entreprises américaines de retrouver leurs positions hégémoniques des années 1960, ni n’ont permis d’améliorer leur profitabilité, d’autant plus que les offres publiques d’achat ont provoqué des endettements substantiels chez certains acheteurs. Dans ce cas, la compétitivité s’est elle néanmoins redressée avec cette nouvelle gestion de l’entreprise ? La réponse est une fois de plus négative notamment parce qu’un « trop grand accent sur les actionnaires au détriment des autres partenaires de l’entreprise peut mener à un exode de ses meilleurs éléments et à un sous-investissement chronique » . Etonnamment en conclut donc Neil Fligstein et malgré des résultats paradoxaux, ce revirement néo-libéral de la valeur actionnariale encensés par certains experts économiques s’est donc bien fait avec l’Etat tant dans un rôle d’encadreur, que de législateur.
La silicon Valley
Prenons maintenant l’expérience de la silicon valley, emblème mondial de la libre entreprise américaine. Ses entreprises en réseau, non hiérarchisées dynamiques et innovantes, leurs capacités à évoluer et à se réinventer en permanence, leur rôle dans la croissance étasunienne, la flexibilité et l’engagement de ses employés, la petitesse des structures productives, l’impossibilité de monopoliser ses secteurs d’activités, l’architecture « ouverte » de ses produits, la compatibilité des systèmes… tout cela participe à cette croyance, sur laquelle s’ancre solidement l’économie des connaissances, à savoir que l’Etat n’interviendrait en aucun cas dans ce secteur économique. Or l’Etat étasunien a toujours tenu un rôle déterminant dans les différentes périodes historiques d’innovation.
L’auteur rappelle ainsi que si la silicon valley existait avant la seconde guerre mondiale, c’est avec la guerre qu’elle a pris son véritable essor, essentiellement grâce à son rôle de fournisseur d’équipements électroniques, de missiles guidés… de l’armée américaine. Hewlett Pakard, vendant plus de 90% de sa production à l’Etat américain, est ainsi passée de 9 à 100 salariés et de 70000 à 1 million de dollars de chiffre d’affaire annuel entre 1939 et 1943. Au début de la guerre froide, le ministère de la défense va devenir le premier soutien financier de la recherche et développement privée mais aussi universitaire. Les liens se sont donc considérablement renforcés entre les universitaires, les ingénieurs privés et l’Etat, plus précisément le ministère de la défense. L’université de Stanford va ainsi jouer un rôle prépondérant dans ces échanges en fournissant des ingénieurs spécialisés pour la Silicon valley. Dans les années 1945 à 1965, le gouvernement fédéral de Californie et le Pentagone poursuivirent leur soutien aux secteurs du transistor, de l’informatique…
Ce n’est donc véritablement qu’aux cours de ces 30 dernières années, que les produits et les cibles de la silicon valley ont évolué.
L’Etat a donc joué un rôle substantiel dans la création de ce pôle (et en joue encore un si l’on considère la question de la brevabilité), le nombre d’ingénieurs qui y travaillent est en partie dû à l’attraction à l’époque de l’industrie militaire et les produits qui y sont développés découlent parfois de commandes effectuées par le Pentagone (c’est le cas d’Internet par exemple).
Quant à la multitude de petites entreprises composant la silicon valley, encore un mythe de plus pour Neil Fligstein. Car le plus souvent elles sont rachetées par des grandes entreprises, quand il ne s’agit pas d’une filiale ou d’un sous-traitant direct, et le niveau de concentration serait parfois extrêmement élevé. S’il faut donner qu’un seul exemple, ce serait celui de Microsoft, mais on pourrait aussi citer celui de Cisco System ou de Aol-Time-Warner.
Cette quasi tradition consistant à décrire l’économie américaine comme performante parce que l’Etat y laisserait jouer librement les forces du marché ne tient donc pas. Car dans les deux exemples étudiés, valeur actionnariale et silicon valley, l’Etat américain fut constamment présent :
-
Premièrement en élaborant les cadres législatifs, juridiques et réglementaires des politiques fiscales, boursières, mais aussi en matière de brevets…
-
Deuxièmement en consommant et en aidant à la recherche et au développement de certains produits avec le rôle substantiel du ministère de la défense.
-
Et enfin en finançant la recherche universitaire.
Et l’auteur de conclure que de toute évidence, « un monde dans lequel les entreprises pourraient trouver des solutions stables à leurs problèmes de concurrence sans l’aide de relations sociales étendues, ou dans lequel les marchés existeraient sans la participation active de l’Etat, est inconcevable » .
Key words
liberalism, innovation, research and development, State intervention
, United states
file
Économie, société et environnement : des éléments de réflexion pour une société durable
Source
Articles and files
FLIGSTEIN Neil, Le mythe du marché : le cas américain in Problèmes économiques n°2738, novembre 2001, pp 17-24

FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) - 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris, FRANCE - Tél. 33 (0)1 43 14 75 75 - Fax 33 (0)1 43 14 75 99 - France - www.fph.ch - paris (@) fph.fr