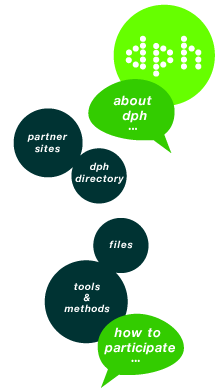De nouveaux rôles pour l’entreprise
Comment la RSE peut-elle aider les entreprises à redéfinir leur rôle ?
04 / 2006
Face à l’ampleur des défis mondiaux et aux nombreuses critiques de notre système économique, que peut-on proposer pour sortir l’entreprise de ses carcans ?
Philippe de Woot nous présente quatre axes de réflexion pour aller vers un renouveau du rôle de l’entreprise :
-
premièrement une finalisation de l’action de l’entreprise
-
le développement d’une éthique de l’avenir
-
la mise en place d’une concertation élargie
-
et enfin, l’intégration de la firme dans un modèle de développement durable.
Quelles finalités pour l’entreprise ?
Philippe de Woot, en s’appuyant sur les écrits d’Aristote, définit l’économie comme un sous système inséparable des sphères de la politique et de l’éthique.
Dans une telle perspective que devient alors la finalité de l’entreprise ? Pour la définir l’auteur prend en compte 3 niveaux d’analyse que sont : l’acte d’entreprendre, qui se définit essentiellement par l’acte d’innover et par un certain dynamisme ; le résultat, qui est la production d’un bien ou d’un service ; et la contribution spécifique de l’entreprise à la société. Il en conclut dans un premier temps que l’entreprise permet un certain progrès matériel mais qui ne peut être abusivement réduit au progrès humain, ou au bien commun d’une société.
Pour déterminer la finalité de l’entreprise, une réflexion approfondie sur la notion de "progrès" et sur les limites du progrès matériel non finalisé semble donc nécessaire.
En effet, si la modernité a longtemps été vue comme un progrès, un éclairage permettant de se libérer des contraintes – par exemple religieuses – elle s’est cependant peu à peu muée en force de domination et d’aliénation. C’est à partir des Lumières explique Touraine, que la raison va progressivement être remplacée par un certain rationalisme s’imposant aux sujets. Si bien qu’aujourd’hui, « l’économie de marché, propulsée par la techno-science, tend à devenir sa propre fin. Le système domine les acteurs (Crozier) et s’enferme dans sa logique particulière : il ne poursuit plus d’autre finalité que celle de son propre développement » (p117). Le progrès matériel peut-il alors de nouveau s’insérer dans la finalité plus globale du progrès de l’homme ou est-ce trop tard ?
En s’appuyant sur les travaux du philosophe Ladrière, Philippe de Woot présente deux types de solutions possibles. La premier consiste à insérer l’entreprise dans le débat démocratique, à créer en quelque sorte une culture politique de l’entreprise afin qu’elle puisse enfin servir le Bien commun et l’intérêt général. Le second vise à définir la finalité de l’entreprise en s’appuyant sur un socle de valeurs larges et communes à la plus grande part de l’humanité (par exemple les droits de l’homme).
Finaliser l’entreprise revient donc à réinsérer les finalités du progrès matériel et technique dans le progrès humain, mais encore faut-il déterminer quel progrès, pour quoi, pour qui et comment ? Seules, les entreprises et le marché ne peuvent répondre à ces questions, une concertation, un débat démocratique est donc, sur ce point, nécessaire. En attendant l’auteur donne sa propre définition de la finalité de l’entreprise : « dans une économie globale, [elle] serait d’assurer le progrès économique et technique dans la perspective d’un progrès humain véritable et d’un débat démocratique sur le type de société que nous voulons construire ensemble » (p123).
L’éthique de l’avenir
Second axe de réflexion de l’auteur : l’éthique. Face au vide politique actuel seule l’éthique, pour l’auteur, de réinventer une culture de l’entreprise.
Cette éthique doit être une éthique de conviction, ne s’appuyant non pas sur de simples règles du jeu mais sur des valeurs aussi universelles que possible, comme les droits de l’homme ou le principe d’humanité (Jean-Claude Guillebaud). Mais seule l’éthique de conviction ne peut suffire. En effet, l’éthique doit être autre chose qu’une déclaration de bonnes intentions. Elle doit être un véritable engagement, car on le sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions. C’est Max Weber qui a particulièrement appuyé cette nécessité de compléter l’éthique de conviction par une éthique de responsabilité et Philippe de Woot le suit sur ce point jugeant qu’une combinaison des deux permettra de faire évoluer les bases de notre développement en asseyant les principes de solidarité et d’humanité. Une entreprise responsable est donc une entreprise qui sait dépasser l’état d’indifférence, qui sait se sentir concerner par les débats démocratiques, les problématiques sociales et environnementales et qui cesse de se convaincre que ces problèmes relèvent uniquement de la puissance publique.
Cette éthique doit également être une éthique de l’avenir, dans un monde ou les conséquences des actes entrepreneuriaux sont éloignés dans le temps ou dans l’espace. En se fondant sur les réflexions du philosophe Jonas, l’auteur caractérise comme suit ce que pourrait être l’éthique de l’avenir :
-
Un de ses premiers fondements serait d’élaborer des aides à l’anticipation, pour permettre la responsabilisation des entreprises et sortir de la domination du court terme.
-
Un second élément de cette éthique de l’avenir serait composé de l’heuristique de la peur, « une exigence d’inquiétude pour toute décision qui engage l’avenir de manière fondamentale » (p133).
-
Autre élément, veiller correctement au commencement. Par-là, l’auteur entend la généralisation de l’application du principe de prudence et de précaution face à certaines innovations.
-
Enfin, dernier principe de cet éthique de l’avenir, la sélection du progrès. Certains progrès peuvent être inacceptables ou ne justifient, par exemple, pas certains coûts…
Cependant, une telle éthique ne saurait prendre la forme d’un code, car il s’agit bien plus d’une culture qui par conséquence différera suivant le lieu, le secteur, la taille, le type de production de l’entreprise. Mais aussi parce qu’une telle démarche doit avant tout être un processus dynamique, une réinterrogation permanente individuelle et collective. Créer des espaces éthiques dans les entreprises semble alors bien plus efficace que la mise en place de codes figés (codes, par ailleurs, qu’Enron et Worldcom possédaient). Déjà aujourd’hui, ce type d’espaces éthiques existe par exemple au sein du Nanoscience Centre de Cambridge.
Une certaine dynamique semble donc s’être mise en œuvre dans le monde de l’entreprise. Mais selon Philippe de Woot, c’est la science qui aujourd’hui pose irrésistiblement le plus grand nombre de problèmes éthiques. Est-il alors possible d’envisager une culture de l’éthique dans le domaine de la science ?
Sans aucun doute pour l’auteur, car si une certaine liberté est le fondement même d’une démarche scientifique, il n’empêche que ses expérimentations, ses résultats et ses applications relèvent encore et toujours de l’éthique : parce qu’il existe une ambiguïté dans l’application de la sciences (on peut en faire une bonne ou mauvaise utilisation) ; parce que la science se caractérise également par une accélération cumulative qui l’éloigne de fait du débat démocratique ; parce que la science est de plus en plus proche de la technologie dont l’exploitation commerciale peut avoir des effets dommageables ; et enfin parce que la science connaît un certains nombres de limites méthodologiques.
Elle doit donc être débattue, mise en dialogue. Pour ce faire, la méthodologie à adopter pourrait être la suivante :
-
fonder la démarche de recherche et de communication scientifiques et des chercheurs sur les principes d’honnêteté et de transparence ;
-
se fonder également sur une analyse complète des applications ;
-
mais aussi sur la recherche d’alternatives ;
-
sur la surveillance des résultats (au fil du temps) ;
-
sur la volonté et le pouvoir d’interrompre toute activité ;
-
et enfin sur la permanence du débat.
Une entreprise citoyenne
Passons maintenant à la question des relations entre entreprises et société, entre entreprise et démocratie. Trop souvent l’entreprise apparaît isolée du reste de la société notamment parce qu’elle consulte rarement quand il s’agit de son domaine de compétence. Comment l’entreprise peut-elle alors faire pour retrouver sa dimension citoyenne ?
Tout d’abord, elle doit accepter de débattre, et reconnaître la dimension citoyenne des revendications des syndicats et des ONG. Mais elle ne peut s’arrêter là et doit approfondir ce processus en organisant et en participant aux concertations. Plusieurs démarches vont aujourd’hui dans ce sens comme celle du Global Impact de l’ONU, du European Multi-Stakeholder Forum créé par le CSR Europe en partenariat avec la commission européenne.
Beaucoup craignent cependant que ces initiatives ne soient que de simples bavardages inutiles dépourvus d’actions concrètes, mais il ne s’agit que d’un début et « dans un monde incertain, complexe, dangereux, le débat vaut mieux que le lobby » (p150).
Ce type de démarche permettrait également d’asseoir les nécessités de transparence et d’évaluation. Aujourd’hui, la transparence demandée dépasse le simple cadre de la comptabilité. C’est sur la nature des produits, les conditions de travail, la pollution qu’elle s’inscrit désormais. De nouveaux outils de comptabilité prenant en compte les exigences sociales et environnementales ont du reste été créés, et de nouvelles normes mises en place. Qui plus est de nombreuses entreprises se sont engagées à publier des rapports traitant de l’externalité de leurs activités ou des conditions de travail. L’indépendance de ces rapports est souvent contestée.
Une réflexion sur une évolution du mode de gouvernance des entreprises s’avérerait donc incontournable ? Cobbaut et Lenoble énoncent ce que pourraient être ces nouveaux principes fondateurs de la gouvernance d’entreprise :
-
premièrement le respect de l’indépendance des administrateurs qui alors pourraient dénoncer les phénomènes de collusion et contrebalancer le poids du dirigeant
-
deuxièmement la création d’un comité d’audit au sein du conseil d’administration
-
dernier principe, faciliter l’écoute des salariés souhaitant dénoncer certaines pratiques ou manœuvres.
Le mouvement des responsabilités sociales aujourd’hui
Toutes ces réflexions présentées par l’auteur sont depuis quelques années présentes dans certaines entreprises. Mais le problème posé par la RSE est de savoir comment faut-il considérer l’engagement des entreprises dans ce domaine ? Est-on en présence d’une équipe sincèrement ancrée dans une démarche citoyenne ou d’un simple choix marketing ?
Philippe de Woot fait le choix de nous présenter quelques entreprises réellement engagées dans ce processus c’est à dire des firmes pour qui la RSE dépasse les logiques de marketing ou de communication. Parmi ces entreprises, on trouve Shell, Lafargue, IBM, Novo Nordisk et Daimler-Chrysler. Car toutes ces firmes ont choisi :
-
le développement durable comme finalité ;
-
sa traduction dans les pratiques, les outils, les méthodes ;
-
une culture de responsabilité ;
-
et de faire de cette évolution un réel processus.
Par exemple l’entreprise Lafargue définit son approche du développement durable en 2002 comme reposant sur « les quatre principaux axes suivants :
-
ouverture, dialogue et partenariat ;
-
création de valeur économique ;
-
progrès social ;
-
protection de l’environnement » (p163)
Mais qu’en est-il de la mise en œuvre concrète de ces beaux principes ?
Et bien, l’auteur constate qu’en règle générale elle prend deux formes. Tout d’abord celle du partenariat, notamment quand il s’agit d’externalités négatives découlant de la production même de l’entreprise. Par exemple, Shell collabore avec Greenpeace et Human Rights, supporte par ce biais la recherche sur les énergies alternatives, tente d’aider au respect des droits de l’homme dans les pays où elle est implantée. Lafarge, avec le World Wildlife Fund, aide à la restauration de ses sites et à la recherche de techniques permettant une réduction des émissions de gaz.
L’autre traduction pratique de ces principes peut être la mise en place de nouveaux outillages comptables (la triple comptabilité : économique, sociale et environnementale) ou de gestion, mais aussi de codes de comportement ou de mesures de résultats.
Dans tous ces exemples, si des transformations ont pu être possible c’est parce que les équipes de direction ont pu s’appuyer sur une culture de l’entreprise forte et ancienne. C’est notamment le cas de Lafarge et de Shell qui dès le milieu des années 1970 ont commencé à intégrer de nouveaux principes d’orientation pour leurs entreprises.
C’est donc un processus à long terme qui a permis la transition vers un modèle d’entreprise responsable.
Certains facteurs suscitent plus que d’autres un changement réussi. Une transition aura plus de chance de se réaliser :
-
s’il existe une pression extérieure et intérieure ;
-
s’il existe une vision partagée, convergente ;
-
s’il la firme dispose d’une certaine capacité d’évolution ;
-
si des programmes concrets, même modestes sont mis en place.
Mais nous n’avons cité là qu’un petit groupe d’entreprises ; qu’en est-il des autres ? Et ce mouvement de RSE est-il généralisable aux autres firmes ?
Il y a effectivement un petit groupe de précurseurs qui, soit ont été obligés de répondre à des crises sociales, politiques ou environnementales (c’est le cas de Shell), ou soit qui ont devancé la demande. Et puis il y a les "autres", ceux qui misent sur les relations publiques et qui au final ont adopté ce nouveau vocabulaire de l’entreprise responsable et du développement durable parce qu’à la mode, et ceux plus conservateurs qui tablent ouvertement sur le modèle néo-libéral. Car le changement bute notamment sur ces cadres et dirigeants tout droit sortis des Business School rarement progressistes, et en général proches de l’idéologie néo-libérale.
Les écoles de gestion sont donc aujourd’hui inadaptées figées dans une certaine pensée unique, elles préparent particulièrement mal leurs étudiants à diriger des entreprises qui devront, qu’elles le veuillent ou non, faire au face aux défis mondiaux, politiques, sociaux et environnementaux. Henry Mintzberg, Sumantra Ghoshal, tous s’accordent à dire que l’enseignement des business school est inefficace, mais qui plus est qu’il n’est pas sans responsabilité dans les dérives des équipes dirigeantes de ces dernières années (Enron, Worldcom, Jean-Marie Messier…).
Le rôle de ces écoles de gestion est fondamental dans la transmission d’un modèle de culture d’entreprise. Pour qu’elles aient un apport bénéfique, il suffirait déjà qu’elles s’ouvrent idéologiquement, et qu’elles proposent des programmes plus universitaires axés non pas uniquement sur la pratique d’outils de base mais sur la réflexion, l’apprentissage de l’esprit critique. L’auteur va même plus loin en prônant un enseignement de la philosophie dans ces écoles.
Autre interrogation face à ce mouvement de RSE : sa durabilité ? Est-ce un effet de mode ? Les entreprises qui ont appliqué les préceptes de cette démarche vont-elle être forcées de faire marche arrière ?
En effet, si aucune étude ne prouve le lien entre performance économique et mise en pratique des principes de RSE, toutes les entreprises citées plus haut affichent de bons résultats, la RSE n’est donc pas incompatible avec les performances économiques.
Mais que se passera t-il en cas de mauvaise conjoncture prolongée? Les entreprises seront-elles tentées de changer de modèles ? Oui pour certaines, comme IBM, qui a clairement admis qu’elle ne pouvait prévoir à l’avance son mode d’ajustement en cas de mauvaise conjoncture. Non pour d’autres, à l’instar de Novo Nordisk, pour qui il est hors de question de faire marche arrière, car choisir des finalités de développement durable est de fait un processus à long terme qui se doit de passer outre les aléas conjoncturels.
En adoptant cette démarche proactive de responsabilité, ces entreprises, espèrent donc :
-
éviter les conflits et tensions sociales,
-
être attractives pour certaines ressources clefs, motiver le personnel, afin de garder ou gagner leur position de leader dans la recherche et l’innovation,
-
et renforcer leurs capacités d’adaptation en cas de renforcement des contraintes législatives sociales ou environnementales.
Comment la généralisation de ce modèle doit-il s’organiser ? Volontairement ou autoritairement ? La logique voudrait qu’un changement volontaire soit plus efficace car émanant d’un projet interne. Cependant rarement ces types d’évolutions se sont faites sans pressions externes de l’Etat ou des citoyens.
L’Etat a donc un rôle à jouer notamment pour renforcer ce processus et l’étendre à d’autres entreprises car une démarche de développement durable ne pourra se faire sans la législation adéquate.
Key words
company, corporate social responsibility, sustainable development, ethics
,
file
Économie, société et environnement : des éléments de réflexion pour une société durable
Source
Book
DE WOOT Philippe, Responsabilité sociale de l’entreprise, faut-il enchaîner Prométhée, Paris : Economica, 2005

FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) - 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris, FRANCE - Tél. 33 (0)1 43 14 75 75 - Fax 33 (0)1 43 14 75 99 - France - www.fph.ch - paris (@) fph.fr