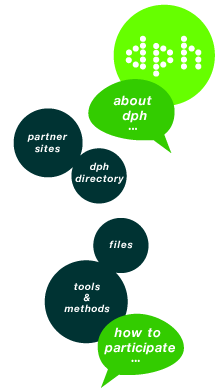La politique, mondialisation et finance
Le point sur l’analyse de l’Ecole de la Régulation et de Robert Boyer
04 / 2006
Robert Boyer, économiste dont la réflexion s’inscrit dans la théorie de la régulation, revient dans ce papier sur les relations entre politique et économie. En effet, il est commun d’entendre dire ça et là que la politique serait impuissante face au développement à l’échelle mondiale du capitalisme contemporain. Une sorte d’unanimité se forgerait ainsi autour de l’universalité et de l’irréversibilité de ce qu’il est convenu d’appeler la « mondialisation » libérale, sorte de rouleau compresseur du déterminisme sinon fatalisme économique. En substance, il n’y aurait rien à faire sinon s’adapter.
La politique ne serait plus à même de guider, d’encadrer, de stopper, de dominer la sphère économique, celle-ci ayant acquis une autonomie quasi totale et ne demanderait qu’à être libérée de ses chaînes, soit de toute législation capable de contraindre le développement du marché.
Bien évidemment, Robert Boyer ne partage pas ce constat et tente donc de dépouiller les rapports entre économie et politique en défendant l’idée que la fin du politique n’est pas à l’ordre du jour.
« Politique et économie : des champs distincts mais interdépendants »
Tout d’abord, l’auteur estime qu’on ne peut cloisonner ces deux champs, néanmoins distincts, que sont l’économie et la politique. En effet, constate-t-il, même si dès l’apparition de l’échange marchand dans les sociétés on assiste immanquablement à une séparation, une dichotomie entre la politique et l’économie - que l’on pourrait représenter schématiquement comme s’il y avait d’un côté les flux de marchandises et de l’autre les questions de pouvoir et de relation entre les individus - ces deux aspects sont néanmoins interdépendants de fait : la puissance économique étant facteur de pouvoir politique et l’intervention facteur de développement économique. Ainsi, l’Etat a bien fini par cadrer puis par intervenir directement dans la sphère économique.
Au vu de l’histoire longue des relations entre politique et économie, R. Boyer estime donc qu’aucune des deux sphères de l’économie et du politique ne peuvent imposer leur logique à l’autre, que l’intervention étatique ne peut être analysée de manière théorique et générale – elle est spécifique, liée au contexte historique de chaque nation – et par conséquent, qu’il n’existe pas de science économique pure. On observe ainsi une pluralité de régulations économiques et politiques.
Le cloisonnement entre la politique et l’économie est donc un mythe de plus à déconstruire.
« Comment la politique a permis l’âge d’or de la croissance mondiale »
D’autant plus que Robert boyer considère l’impact de la politique sur l’économie comme étant du meilleur effet.
A l’instar de la croissance exceptionnelle des 30 glorieuses, intrinsèquement liée aux contraintes imposées par l’Etat en matière d’évolution sociale et de politique. En effet, pour la première fois estime l’auteur, les salariés ont été insérés politiquement et économiquement dans les sociétés, l’Etat devenant non plus uniquement celui du capital mais aussi celui du salariat.
Le rapport salarial a donc joué un rôle prépondérant dans le dynamisme économique d’après guerre. Ainsi, paradoxalement, et contrairement aux conclusions de la théorie standard néoclassique à libérale, ce sont des rigidités institutionnelles, rigidités interférant dans le marché du travail, qui ont permis, voire qui sont le fondement même de cette période de prospérité. C’est donc un compromis politique entre le travail et le capital qui serait à l’origine de ces années de croissance mondiale, exemple s’il en fallait de l’interdépendance entre le politique et l’économie.
« Pourquoi tous les capitalismes ne se ressemblent pas : convergences théoriques »
Cette interdépendance permet d’envisager la coexistence de différents types de capitalismes. Robert Boyer distingue ainsi 4 formes principales de capitalismes reposant sur 4 formes de régulation bien spécifiques : le capitalisme à régulation marchande, le capitalisme japonais à régulation dite méso-corporatiste ou qualifié encore de libéralisme paternaliste, le capitalisme social démocrate et enfin le capitalisme à régulation étatique ou publique (1).
« Une déstabilisation générale des compromis politiques et des modes de régulation »
Ces différentes trajectoires capitalistes sont donc présentes au sortir des 30 glorieuses, apogée du fordisme. Cependant, et ce n’est définitivement plus une nouvelle, le fordisme n’est plus. Le blocage de ce type de croissance va vite se répandre à toutes économies industrialisées ou en voie d’industrialisation via l’extension obligée du commerce mondial. Aussi rapidement à partir des 1980, le régime de demande fondé sur la consommation de masse va laisser place au dynamisme de l’investissement direct, le capital financier reprenant les rênes du capitalisme mondial. Pour Boyer, la quasi disparition du fordisme est pleinement due au laminage de son fondement même : le compromis capital-travail mis à mal par l’érosion progressive du pouvoir de négociation des salariés, le chômage croissant.
« Un basculement de la hiérarchie des formes institutionnelles »
Ainsi, dans les années 1990, le compromis travail-capital va perdre sa domination hiérarchique au profit de l’insertion dans l’économie internationale. Toutes les institutions vont être atteintes par ce bouleversement stratégique : déstabilisation de la forme de concurrence oligopolistique fondée sur une base nationale, mobilité internationale des capitaux, évolution des relations Etat-économie (passage d’un Etat keynésien à un Etat bien plus frugal), mutation du rapport salarial (impossibilité de maintenir un rapport salarial uniforme).
Mais, insiste Boyer, il ne s’agit pas là d’un retour à un capitalisme comparable à celui du 19e siècle, comme le présentent trop souvent certains analystes. Notamment parce qu’entre autre les salariés – habitués notamment en Europe à une certaine évolution sociale – ont des attentes. Mais aussi parce qu’aujourd’hui la très grande majorité des pays industrialisés évoluent dans des systèmes démocratiques et ou encore parce que le capitalisme évolue en spirale ne repassant jamais deux fois par le même configuration, le même état, comme l’estime la Théorie de la Régulation.
« L’internationalisation : pas une fatalité économique mais un choix politique »
C’est entre autre cette évolution du capitalisme que l’on a tendance à englober trop facilement dans ce concept fourre tout qu’est la « globalisation » .
Pour Robert Boyer, ce terme polysémique obscurcit plus qu’il ne permet d’éclairer la mutation des nouveaux modes de régulation et de surcroît provoque un sentiment d’impuissance et d’irréversibilité des Nations et des individus face à une sorte de déterminisme économique et financier implacable.
Ainsi, plusieurs définition sont attribuables à la globalisation :
-
la décomposition des oligopoles à l’échelle nationale
-
la fin de l’Etat-Nation
-
la recomposition sociale au sein des Etats-nations
-
l’intégration économique régionale…
Mais R. Boyer insiste : en aucun cas la politique n’est subordonnée aujourd’hui à l’économie. L’économie et la finance ne dictent pas leurs lois à la politique pas plus qu’il n’existe de déterminisme économique. En effet, ce sont les gouvernements qui ont choisi de libéraliser les marchés de la finance et de la monnaie. A l’instar de la Suède qui a décidé de s’ouvrir à la finance internationale bien avant de connaître des difficultés économiques. En outre, c’est après cette ouverture qu’elle en a connu.
La déréglementation qui a eu lieu à la fin des années 1970 et au début des années 1980 est donc une stratégie ou du moins une volonté des gouvernements et non d’un utopique marché.
« La décennie quatre-vingt-dix : les mauvaises régulations vont-elles chasser les bonnes ? »
Une nouvelle donne économique et politique est donc aujourd’hui bien présente. En effet, si les diverses trajectoires capitalistes que nous avons décrites précédemment étaient bien plus complémentaires que concurrentes, la bulle financière du Japon, la stagnation économique de l’Europe parallèlement au retour en force de la croissance étasunienne vont mettre à mal la persistance de cette taxinomie. Ainsi, aussi bien le Japon que l’Europe vont peu à peu être tentés d’importer les formes institutionnelles spécifiques du capitalisme marchand. Un schéma préoccupant selon Robert Boyer car remettant en cause fondamentalement le consensus politique et social prévalant au sortir de la seconde guerre mondiale. Ce type de capitalisme ne serait qui plu est pas des plus efficient. En effet, si l’on observe son emblème, à savoir les Etats-Unis, on comprend vite ses limites systémiques en terme de productivité notamment qui peut se résumer par la problématique suivante : pourquoi faire des efforts en terme d’innovation si la flexibilité des salaires permet de prolonger des procédés de production obsolètes voire inefficient ?
« Oser remettre en cause le syllogisme : la globalisation implique la convergence donc la fin du politique »
Robert Boyer suggère donc en substance que l’efficacité n’est pas le critère principal qui guide la forme prise par le capitalisme, celle-ci serait en outre bien plus déterminée par sa compatibilité avec l’environnement international. Mais cette trajectoire capitaliste s’impose-t-elle inéluctablement à l’échelle mondiale comme le prédisent certaines analyses. Assisterait-on aujourd’hui à une convergence capitaliste engendrant la fin tant redoutée du politique ?
Robert Boyer s’oppose formellement à cette analyste simpliste. En effet, il y a bien aujourd’hui une domination à l’échelle mondiale du capitalisme patrimonial (i.e : forme de capitalisme dont la croissance est tirée par la financiarisation) de là à parler de convergence... car si convergence du capitalisme il y avait, on observerait une convergence des prix (convergence des taxes, des politiques monétaires, des politiques redistributives…) or rien de tout cela ne semble se produire.
L’auteur en conclut donc que le retour au marché roi s’explique avant tout comme « un antidote aux failles de l’action collective…que les interventionnistes avaient négligé de prendre en compte dans leur défense et illustration de l’Etat » (p53).
« Un régime d’accumulation gouverné par la finance : une stabilité qui n’est pas garantie »
Mais ce retour de la domination de la finance est-il durable ? Ceci est peu probable pour l’économiste, ce type de capitalisme engendrant trop de conséquences déstabilisantes :
Il oblige tout d’abord les firmes à repenser leurs gouvernances, le pouvoir de l’actionnaire devenant substantiel. Il pousse également les dirigeants à revoir leurs méthodes de gestion (réaction aux cycles économiques…). Ainsi, la forme de la concurrence et le rapport salarial s’en trouvent profondément bouleversés. Le comportement des ménages doit également évoluer, l’arbitrage entre épargne et consommation étant renforcé. Enfin cette trajectoire entraîne également une mutation des relations entre Etat et économie (financiarisation du taux de change, rigueur budgétaire…).
Elle apporterait donc son lot de contradictions internes : la spéculation à très court terme, l’accumulation et la redistribution de la valeur ajoutée en faveur du profit, des tensions entre la logique du capitalisme marchand et la tradition démocratique, l’absence d’évolution des instances de régulation internationale alors qu’elles doivent désormais remplir de nouveaux rôles.
Ainsi pour Robert Boyer, si on entre bien dans une nouvelle internalisation, dans un approfondissement de l’internationalisation, pour autant la globalisation est partielle et se concentre essentiellement dans le secteur de la finance. Le politique et la politique ne sont pas morts, bien au contraire, il faut absolument sortir de ce fatalisme et déterminisme économique. Les interventions publiques restent donc efficaces et même bien plus que le marché en matière de décisions stratégiques sociétales ce qui explique notamment l’existence de diverses trajectoires économiques capitalistes.
Key words
capitalism, economic globalization, politics
file
Économie, société et environnement : des éléments de réflexion pour une société durable
Source
Book
BOYER Robert, La politique à l’ère de la mondialisation, CEPREMAP-GERME, papier n°9820.
CEPREMAP : www.cepremap.cnrs.fr

FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) - 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris, FRANCE - Tél. 33 (0)1 43 14 75 75 - Fax 33 (0)1 43 14 75 99 - France - www.fph.ch - paris (@) fph.fr